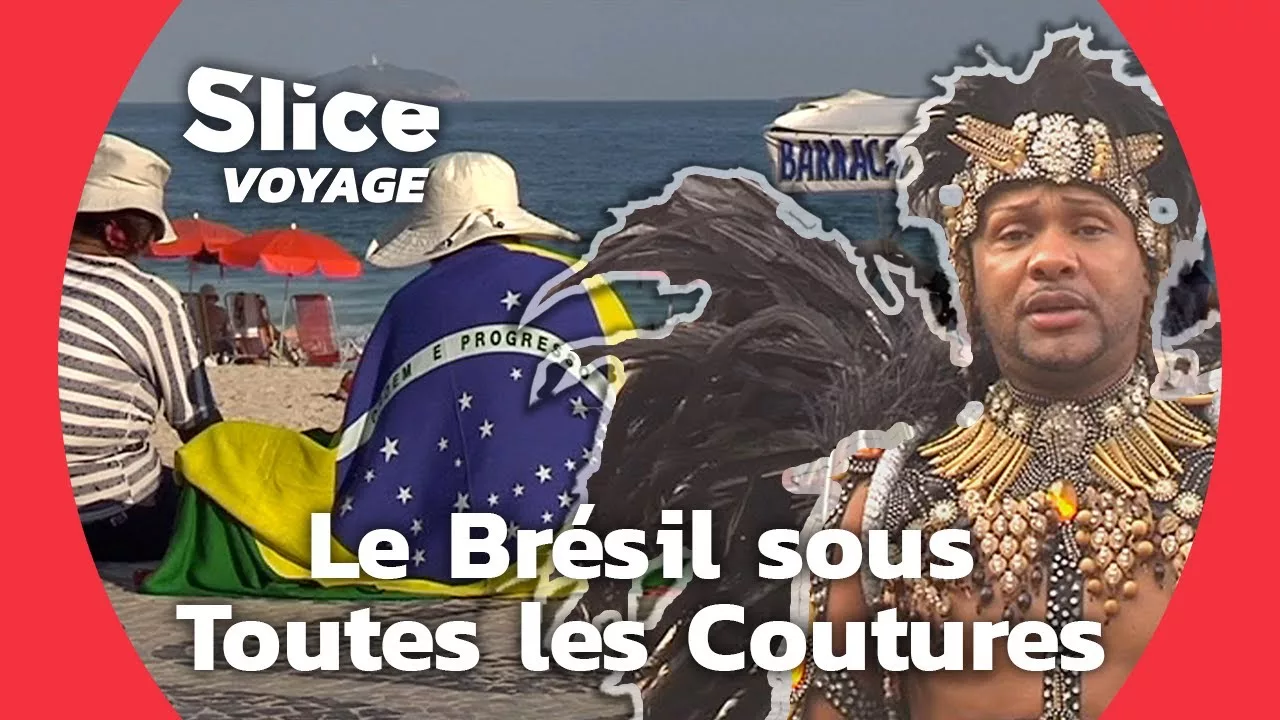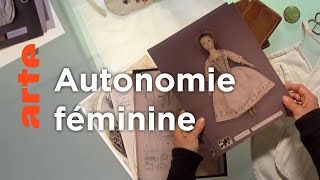La proposition de loi « fast fashion » devait incarner le volontarisme français. Votée à l’unanimité, elle fut présentée comme un signal fort envoyé aux géants venus d’Asie. Mais le contraste est saisissant : à Bruxelles, la Commission a balayé l’essentiel du texte, jugeant ses dispositions incompatibles avec le droit de l’Union.
Ce n’est pas seulement un revers juridique : c’est un nouvel épisode où la France donne l’image d’un pays qui s’agite beaucoup mais pèse de moins en moins dans la fabrique des normes européennes.
Résumé des points abordés
L’unanimité nationale, l’échec européen
À Paris, on s’est félicité d’un rare consensus politique autour d’une loi présentée comme ambitieuse. Droite et gauche, majorité et opposition, tous avaient applaudi une initiative qui, disait-on, prouvait que la France savait encore s’unir quand l’intérêt général l’exigeait.
Mais cette unanimité nationale s’est fracassée sur la réalité européenne. Sept articles sur douze ont été retoqués, dont les dispositions centrales : définition des acteurs visés, interdiction de la publicité, sanctions environnementales. Autrement dit, le cœur de la loi a disparu en un instant.
Derrière l’élan politique, c’est une impréparation juridique flagrante qui apparaît. Et cette légèreté a un prix. Aux yeux de nos partenaires, la France donne le spectacle d’un pays qui se congratule d’avoir voté une « loi pionnière », alors qu’elle était condamnée d’avance. L’unanimité, loin de renforcer notre crédibilité, expose au contraire notre faiblesse : nous parlons haut, nous votons vite, mais nous échouons à transformer cet élan en action conforme et durable.
Le réflexe du passage en force
Plutôt que d’admettre l’échec, la rapporteure Anne-Cécile Violland a choisi d’écrire au Premier ministre Sébastien Lecornu pour réclamer une commission mixte paritaire. Une démarche paradoxale : pourquoi précipiter la procédure nationale quand Bruxelles a déjà écarté les dispositions essentielles ?
Cette obstination illustre un travers français : préférer sauver la mise politique, coûte que coûte, plutôt que de bâtir une stratégie crédible à l’échelle de l’Union.
Une influence en recul
L’épisode fast fashion n’est pas isolé. Il illustre une perte d’influence plus large : la France apparaît comme un pays prompt aux indignations et aux textes symboliques, mais incapable de transformer ses élans en résultats concrets.
Pendant que d’autres États avancent leurs priorités avec méthode, Paris donne le spectacle d’une puissance qui parle fort mais compte de moins en moins. C’est là le vrai danger : à force de confondre communication nationale et stratégie européenne, la France s’affaiblit durablement à Bruxelles.
Et ce temps perdu n’est pas neutre. À force de multiplier des lois nationales condamnées à l’échec, nous donnons à nos entreprises un faux sentiment de protection, avant de les abandonner face à une concurrence dérégulée. Nous leur faisons croire qu’elles pourront se sauver sans rien changer, alors que c’est un leurre.
Au bout du compte, ce double discours – volontarisme affiché, impuissance réelle – fragilise à la fois notre économie et notre crédibilité. Il ne reste ni un cadre juridique robuste, ni une stratégie politique lisible, seulement des occasions manquées.