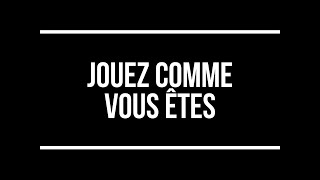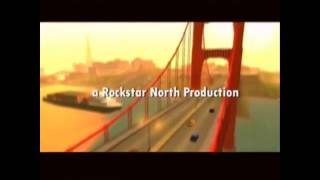La Super Nintendo Entertainment System, souvent abrégée en SNES ou Super NES, demeure l’une des pierres angulaires de l’histoire du jeu vidéo. Lancée au début des années 1990, cette machine 16-bits a non seulement défini l’enfance de millions de joueurs à travers le monde, mais elle a également posé les standards de gameplay, de narration et de musique qui perdurent encore aujourd’hui.
Pourtant, derrière les succès retentissants de Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past ou Chrono Trigger, se cachent des histoires fascinantes et des détails techniques souvent méconnus du grand public.
Au-delà de sa ludothèque légendaire, la console de Nintendo porte en elle les stigmates de décisions industrielles audacieuses, d’erreurs stratégiques majeures et d’innovations technologiques bien trop en avance sur leur temps.
Résumé des points abordés
Une trahison industrielle à l’origine de la PlayStation
L’histoire du jeu vidéo est jalonnée de rivalités, mais aucune n’est aussi ironique que celle ayant mené à la création de la PlayStation. Il est fascinant de constater que la console qui a fini par détrôner Nintendo de sa position de leader mondial est, en réalité, le fruit d’un partenariat avorté initié par Nintendo elle-même.
À la fin des années 1980, le support CD-ROM commence à faire parler de lui comme le futur du stockage de données, offrant des capacités bien supérieures aux cartouches traditionnelles. Nintendo, souhaitant ne pas se laisser distancer par la concurrence, notamment NEC et sa PC Engine, décide de s’associer avec le géant de l’électronique Sony.
L’objectif est double : développer une puce sonore de haute qualité pour la future SNES (le fameux chip SPC700 créé par Ken Kutaragi) et concevoir un lecteur de CD-ROM périphérique, provisoirement baptisé « Play Station ».
Le projet avance bien, et des prototypes hybrides capables de lire à la fois des cartouches SNES et des CD sont fabriqués. Cependant, en relisant les termes du contrat, le président de Nintendo de l’époque, Hiroshi Yamauchi, réalise une faille critique. L’accord original laissait à Sony le contrôle total sur le format des disques et, par extension, sur les royalties des jeux publiés sur ce support. Pour une entreprise comme Nintendo, habituée à une hégémonie totale sur son écosystème, c’était inacceptable.
La réponse de Nintendo fut brutale et publique. Lors du CES de 1991, au lendemain de l’annonce par Sony de leur partenariat, Nintendo monte sur scène pour déclarer qu’ils travaillent désormais avec le rival néerlandais de Sony, Philips. C’est une humiliation publique sans précédent pour la firme japonaise.
Furieux et trahis, les dirigeants de Sony envisagent d’abord d’abandonner le secteur. C’est sans compter sur la ténacité de Ken Kutaragi, qui convainc sa direction de ne pas jeter l’éponge. Utilisant la technologie déjà développée pour Nintendo, Sony décide de faire cavalier seul.
Trois ans plus tard, la PlayStation sort, marquant le début de la fin pour la domination sans partage de Nintendo sur les consoles de salon. Ce divorce historique reste l’un des plus grands « et si ? » de l’industrie.
Le Satellaview ou le futur avant l’heure
Bien avant la démocratisation de l’ADSL, du Xbox Live ou du PlayStation Network, Nintendo explorait déjà les possibilités du jeu en ligne et du contenu téléchargeable. Cette innovation, presque inconcevable pour le milieu des années 90, portait le nom de Satellaview.
Commercialisé exclusivement au Japon en 1995, le Satellaview était un périphérique qui se connectait à la base de la Super Famicom (la version japonaise de la SNES). Ce modem satellite permettait de recevoir des données via le réseau de diffusion de la société St.GIGA.
Le concept était révolutionnaire : à des heures précises de la journée, les joueurs pouvaient allumer leur console pour télécharger des jeux, des magazines numériques et des données additionnelles. Ces contenus étaient stockés sur une cartouche mémoire réinscriptible spéciale, insérée dans le port classique de la console.
L’aspect le plus fascinant de cette technologie résidait dans les jeux « SoundLink ». Il s’agissait d’expériences ludiques diffusées en direct, synchronisées avec une piste audio radio transmise par satellite. Imaginez jouer à un Zelda inédit (BS Zelda no Densetsu) où la musique est orchestrale et où de vrais acteurs doublent les personnages en temps réel, vous donnant des indices vocaux pour résoudre des énigmes.
Cette expérience était par nature éphémère. Si vous ratiez l’heure de diffusion, vous ne pouviez pas jouer. C’était un rendez-vous télévisuel interactif, créant une communauté de joueurs connectés simultanément, bien avant les MMO modernes.
Malheureusement, le coût élevé de l’équipement et la complexité logistique ont empêché le Satellaview de sortir des frontières nippones. Le service a continué jusqu’en 2000, mais il reste aujourd’hui une curiosité technologique majeure, prouvant que Nintendo avait compris l’importance de la dématérialisation et du jeu connecté des décennies avant qu’ils ne deviennent la norme industrielle.
Le mystère chimique du jaunissement des consoles
Quiconque collectionne ou possède encore une Super Nintendo d’époque a probablement remarqué un phénomène étrange : certaines consoles ont conservé leur gris d’origine, tandis que d’autres ont viré à une teinte jaune-brunâtre peu esthétique.
Pendant longtemps, une légende urbaine tenace attribuait ce changement de couleur à l’environnement des joueurs, suggérant que la fumée de cigarette ou la saleté incrustée en étaient les causes principales. Bien que ces facteurs puissent jouer un rôle mineur, la véritable raison est purement scientifique et trouve sa source dans la composition même du plastique utilisé.
Pour respecter les normes de sécurité incendie de l’époque, Nintendo, comme beaucoup d’autres constructeurs d’électronique, utilisait du plastique ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) mélangé à des agents ignifuges, plus précisément du brome. Ces retardateurs de flamme ont pour fonction de ralentir la combustion en cas de court-circuit interne.
Le problème réside dans l’instabilité chimique de ce mélange. Lorsqu’il est exposé aux rayons ultraviolets (la lumière du soleil, et même certaines lumières artificielles) et à la chaleur dégagée par la console, le brome subit une réaction d’oxydation. Cette réaction casse les liaisons moléculaires et fait remonter les pigments jaunâtres à la surface du plastique.
Ce qui rend le phénomène aléatoire, c’est que Nintendo a utilisé plusieurs fournisseurs de plastique et différents mélanges au cours de la vie de la console. Certains lots avaient un dosage de stabilisateur UV incorrect, rendant ces consoles spécifiques beaucoup plus susceptibles de jaunir que d’autres produites quelques mois plus tard.
Il est important de noter que ce jaunissement est purement cosmétique. Il n’indique en rien une dégradation des composants électroniques internes. La console fonctionne parfaitement, même si elle ressemble à un vieil ordinateur des années 70.
Aujourd’hui, des procédés chimiques amateurs comme le « Retrobright » permettent d’inverser temporairement ce processus, mais la teinte jaune finit souvent par revenir, rappelant inlassablement la chimie complexe de nos jouets d’enfance.
Un design américain pensé contre les canettes de soda
L’esthétique de la Super Nintendo varie radicalement selon la région du monde où vous avez grandi. Les joueurs européens et japonais ont connu la console sous ses formes arrondies, compactes et élégantes, arborant le fameux logo aux quatre couleurs (rouge, bleu, vert, jaune).
En revanche, les joueurs nord-américains ont eu droit à une machine totalement différente : une boîte angulaire, massive, aux teintes violettes et grises.
Cette différence drastique n’était pas un hasard, mais le résultat d’une réflexion menée par Lance Barr, le designer de Nintendo of America. À l’époque, la filiale américaine craignait que le design japonais, jugé trop « mou » et « organique », ne séduise pas le jeune public américain, plus habitué à des produits technologiques au look agressif et futuriste.
Cependant, une raison beaucoup plus pragmatique et insolite a guidé le coup de crayon de Lance Barr. Lors de l’analyse du modèle japonais (la Super Famicom), l’équipe américaine a identifié un défaut de conception potentiel lié aux habitudes de consommation locales.
La console japonaise présentait une surface supérieure parfaitement plate. Pour Lance Barr, cela représentait une invitation implicite pour les joueurs à y poser leur boisson. Le risque était évident : une canette de soda froide produisant de la condensation, ou pire, un verre renversé, pouvait faire couler du liquide directement dans le port cartouche ou les fentes d’aération, détruisant instantanément la machine.
Pour contrer ce comportement, Barr a dessiné la version américaine avec une surface supérieure bombée et irrégulière, rendant impossible l’équilibre d’une canette ou d’un verre. Si l’esthétique « carrée » de la SNES américaine a souvent été critiquée par rapport à la finesse du modèle original, elle cache en réalité une ergonomie préventive astucieuse.
En plus de cette protection anti-boisson, les cartouches américaines furent également redessinées pour être plus rectangulaires et robustes, renforçant l’aspect « béton » de la machine. Ce choix de design, bien que controversé sur le plan visuel, témoigne de l’attention méticuleuse portée par Nintendo à l’usage réel de ses produits, jusqu’à anticiper la maladresse de ses jeunes utilisateurs.