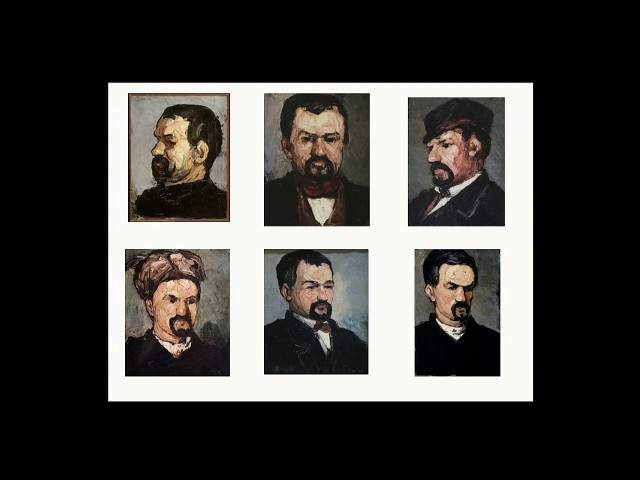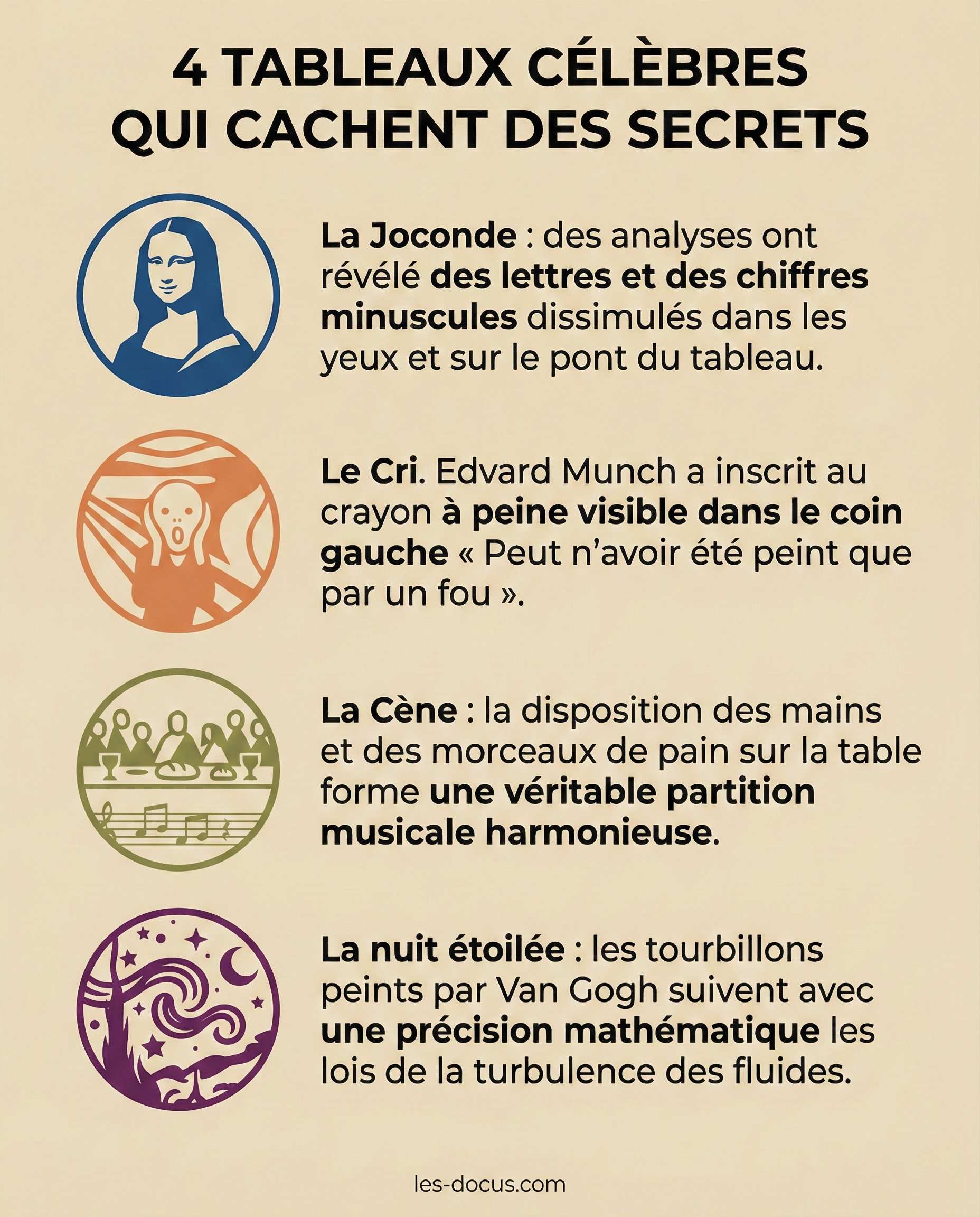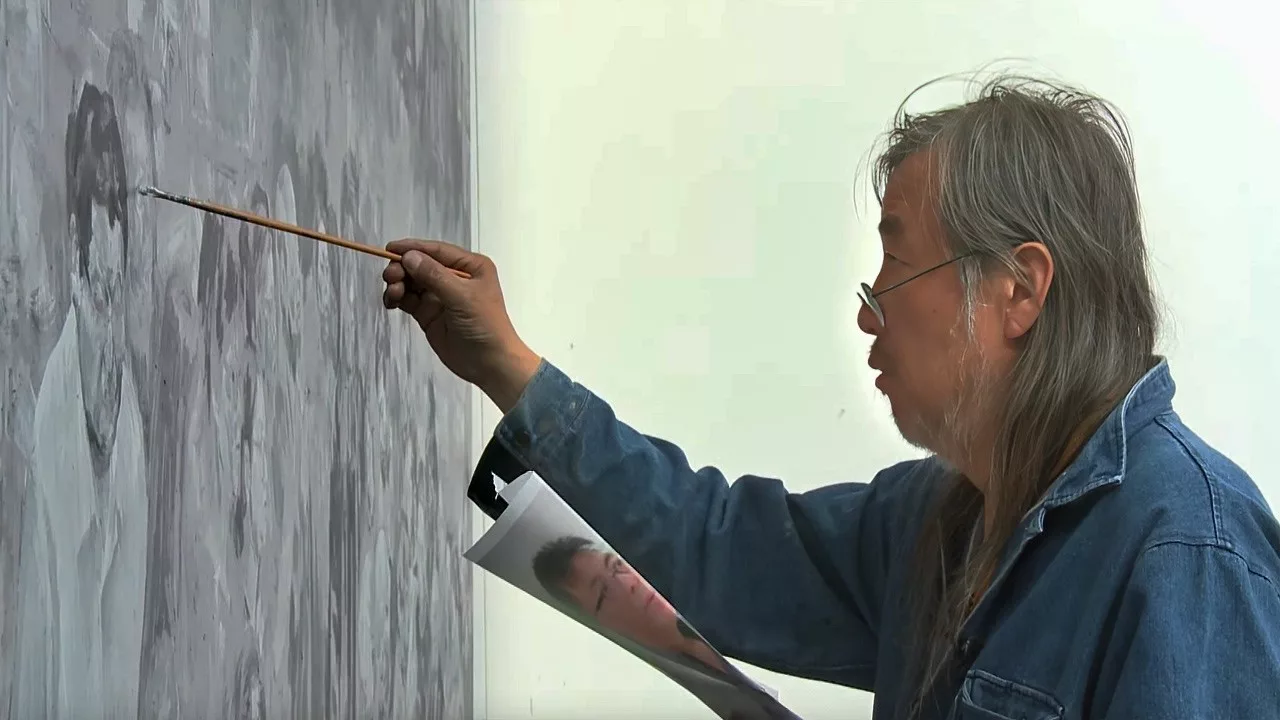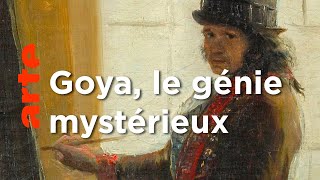Le street art, né dans l’effervescence urbaine des métropoles, s’est longtemps construit dans l’ombre des murs, des palissades et des façades abandonnées. À ses débuts, il incarnait une forme de protestation spontanée, un cri anonyme inscrit dans l’espace public pour revendiquer un droit à la parole que les institutions ne semblaient pas offrir. Graffitis politiques, collages poétiques, pochoirs incisifs ou fresques monumentales : chaque geste cherchait à capter l’attention des passants et à perturber la monotonie visuelle de la ville.
Avec le temps, ces messages, d’abord perçus comme transgressifs, ont acquis une véritable légitimité culturelle. Les artistes ont affiné leur technique, élargi leurs intentions, interrogé la société à travers des codes visuels de plus en plus élaborés. Ce qui n’était qu’un acte clandestin s’est mué en langage esthétique, capable de dénoncer les injustices, de questionner la consommation de masse, de défendre les minorités ou de célébrer la diversité. Le mur est devenu un livre ouvert, offert à tous, où se croisent humour, colère, poésie et utopie.