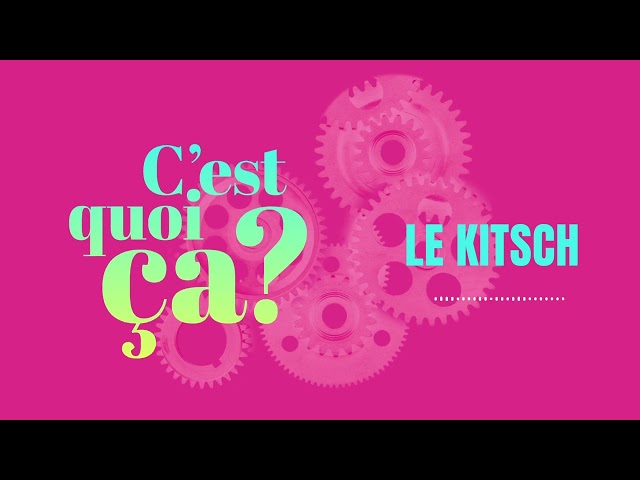Longtemps considéré comme un symbole d’audace, le string n’a pourtant rien d’un phénomène récent. Bien avant de devenir une pièce iconique de la lingerie féminine, il s’inscrivait déjà dans les pratiques vestimentaires de civilisations anciennes.
Son parcours, oscillant entre provocation et libération, en dit long sur l’évolution des mœurs et du rapport au corps.
Résumé des points abordés
Des origines archaïques à la discrétion assumée
Bien avant la naissance de la culotte moderne, certaines tribus primitives d’Amazonie, d’Afrique ou d’Asie utilisaient un pagne ou un cache-sexe rudimentaire, principalement porté par les hommes.
L’un des exemples les plus marquants reste celui d’Ötzi, cet homme préhistorique retrouvé momifié dans les Alpes, qui portait déjà une forme de sous-vêtement minimaliste.
Au fil des siècles, cette pièce basique évolue. En Égypte ancienne, en Grèce ou au Japon, on en retrouve des équivalents fonctionnels, bien que rarement associés à l’érotisme.
Il faudra attendre le XXe siècle pour que le string devienne une véritable déclaration stylistique.
L’essor du string moderne
C’est dans l’Amérique puritaine des années 1930 qu’un événement inattendu contribue à sa naissance contemporaine.
Pour contourner la censure imposée aux danseuses de cabaret, un compromis est trouvé : couvrir l’essentiel, sans masquer les fesses. Le string devient alors un accessoire de scène, plus réglementaire que provocateur.
Mais c’est au Brésil, dans les années 1940, qu’il commence à se démocratiser, notamment sur les plages de Rio. Pensé pour bronzer sans traces, ce bas de maillot effilé devient synonyme de liberté corporelle et de sensualité solaire.
Une femme ingénieuse, en coupant les bords de son bikini, aurait même popularisé sa forme actuelle.
De la marginalité à la révolution esthétique
Dans les années 70, le string apparaît timidement en Europe, réservé à quelques initiées. Il est alors associé à une image sulfureuse, cantonné aux sex-shops et aux cabarets.
Mais la mode évolue, les coupes de pantalons se resserrent, et le besoin d’un sous-vêtement invisible se fait sentir. Le string répond à cet impératif esthétique et entre progressivement dans le dressing féminin.
À partir des années 80, il devient un outil d’émancipation. Les marques osent des campagnes publicitaires audacieuses, valorisant le corps au lieu de le dissimuler. Le string se transforme alors en manifeste : non plus pour séduire, mais pour s’affirmer.
Entre pop culture, polémique et réappropriation
Durant les années 90 et 2000, la culture mainstream s’empare du string. Chanteuses pop, clips MTV et mode urbaine en font un emblème sexy, parfois caricatural. Il s’invite même dans les débats politiques et féministes, tantôt vu comme objet de désir, tantôt comme instrument de soumission.
Cette ambivalence crée une tension : rejeté par certains, il est réaffirmé par d’autres comme un choix libre et assumé.
Aujourd’hui : le string dans toute sa diversité
Loin des clichés, le string s’est stabilisé dans le paysage de la lingerie sexy comme de la lingerie dites plus fonctionnelle.
Il existe désormais en coton doux, en dentelle raffinée, en microfibre invisible, avec des coupes adaptées à toutes les morphologies. Des déclinaisons comme le tanga permettent à chacune d’y trouver sa version idéale. Discret, sensuel, moderne, il reste l’allié des tenues ajustées et le complice de la séduction maîtrisée.
À la croisée de l’histoire, de la mode et de l’intime, le string incarne bien plus qu’un simple sous-vêtement. Il reflète une liberté de choix, une esthétique assumée, et un art de vivre tourné vers l’élégance.
Pour celles qui recherchent la pièce parfaite, Glamuse propose un éventail exceptionnel de modèles, matières et styles jusqu’à la taille 56 et au bonnet O. De la lingerie invisible à la dentelle précieuse, en passant par les plus grandes marques françaises et internationales, le site accompagne chaque femme dans sa quête du beau, du confort et de la confiance.