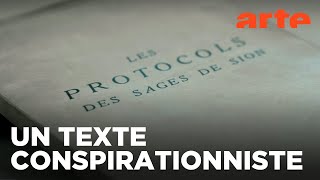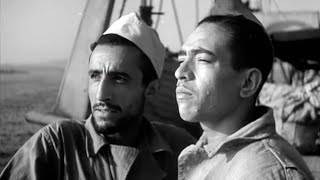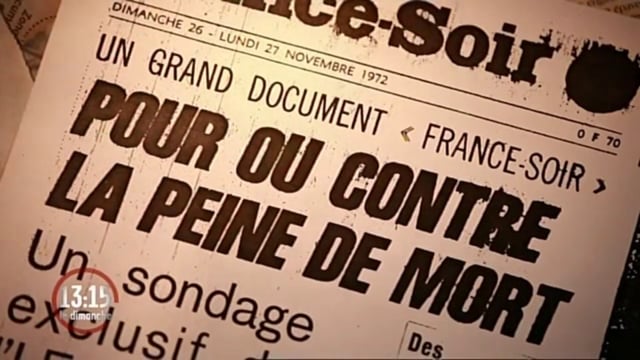La guerre froide, période de tensions extrêmes entre les États-Unis et l’URSS, a façonné le monde de l’après-guerre pendant plus de quatre décennies. Sans affrontement direct entre les deux superpuissances, elle s’est traduite par une succession de crises, de doctrines et d’alliances militaires.
Voici quatre dates essentielles qui permettent de comprendre les grands tournants de cette période.
Résumé des points abordés
1947 : La doctrine Truman lance l’affrontement idéologique
Le 12 mars 1947, le président américain Harry Truman prononce un discours devant le Congrès dans lequel il annonce son intention de soutenir tout pays menacé par le communisme. Ce discours marque la naissance de la doctrine Truman, fondement de la politique d’endiguement (ou « containment ») des États-Unis face à l’expansion soviétique.
Cette date est considérée comme le point de départ officiel de la guerre froide, car elle institue une opposition franche entre le bloc de l’Ouest (capitaliste) et le bloc de l’Est (communiste). En soutenant notamment la Grèce et la Turquie, les États-Unis inaugurent une politique d’influence mondiale.
1949 : L’OTAN formalise le camp occidental
Le 4 avril 1949, les États-Unis, le Canada et dix pays européens signent le Traité de l’Atlantique Nord, donnant naissance à l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord). Il s’agit d’une alliance militaire qui repose sur le principe de la défense collective : une attaque contre l’un des membres est une attaque contre tous.
Ce pacte militaire renforce la division de l’Europe en deux blocs : à l’OTAN s’opposera, en 1955, le Pacte de Varsovie, alliance militaire soviétique. La course aux armements et l’équilibre de la terreur prennent alors une ampleur croissante.
1962 : La crise des missiles de Cuba, sommet des tensions
Du 16 au 28 octobre 1962, les États-Unis découvrent l’installation de missiles soviétiques à Cuba, à quelques centaines de kilomètres des côtes américaines. Le président John F. Kennedy impose un blocus naval autour de l’île pour empêcher l’arrivée de nouveaux armements.
La planète est alors au bord de la guerre nucléaire. Après 13 jours de tensions extrêmes, un accord est trouvé : l’URSS retire ses missiles contre une promesse américaine de ne pas envahir Cuba et le retrait discret de missiles américains en Turquie.
Cette crise est l’un des moments les plus périlleux de la guerre froide, mais elle marque aussi le début d’une volonté de désescalade et de communication entre les deux camps.
1989 : La chute du mur de Berlin, symbole de la fin
Le 9 novembre 1989, après des semaines de manifestations pacifiques et sous la pression populaire, la RDA (Allemagne de l’Est) annonce l’ouverture de ses frontières. Des milliers d’Allemands de l’Est franchissent alors librement le mur de Berlin, construit en 1961 pour les empêcher de fuir à l’Ouest.
La chute du mur devient le symbole fort de l’effondrement du bloc soviétique. Elle entraîne la réunification allemande en 1990 et précède la dissolution de l’URSS en 1991. C’est la fin du monde bipolaire, et donc de la guerre froide.
Conclusion
Ces quatre dates illustrent les grands moments de la guerre froide : son commencement idéologique avec la doctrine Truman, sa militarisation avec la création de l’OTAN, son point culminant avec la crise des missiles de Cuba, et sa conclusion avec la chute du mur de Berlin. Elles permettent de mieux comprendre un conflit sans guerre directe, mais dont les répercussions ont structuré la géopolitique mondiale du XXe siècle.