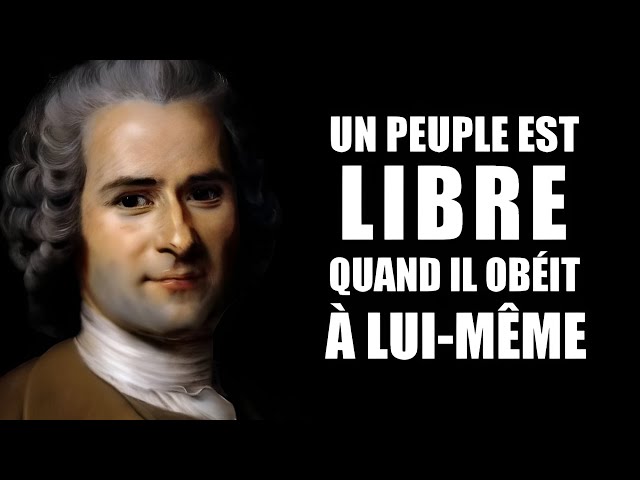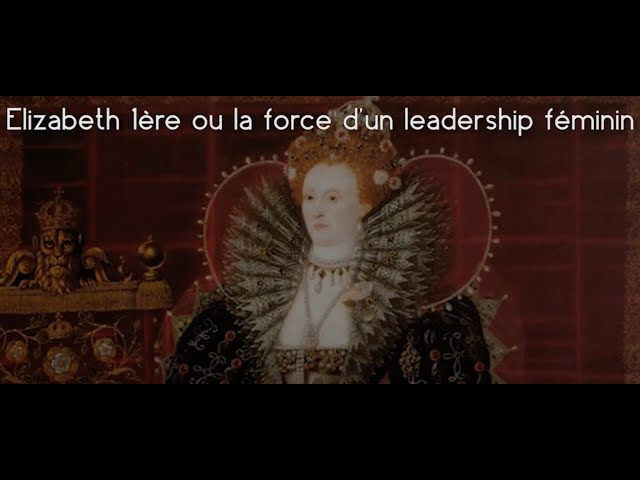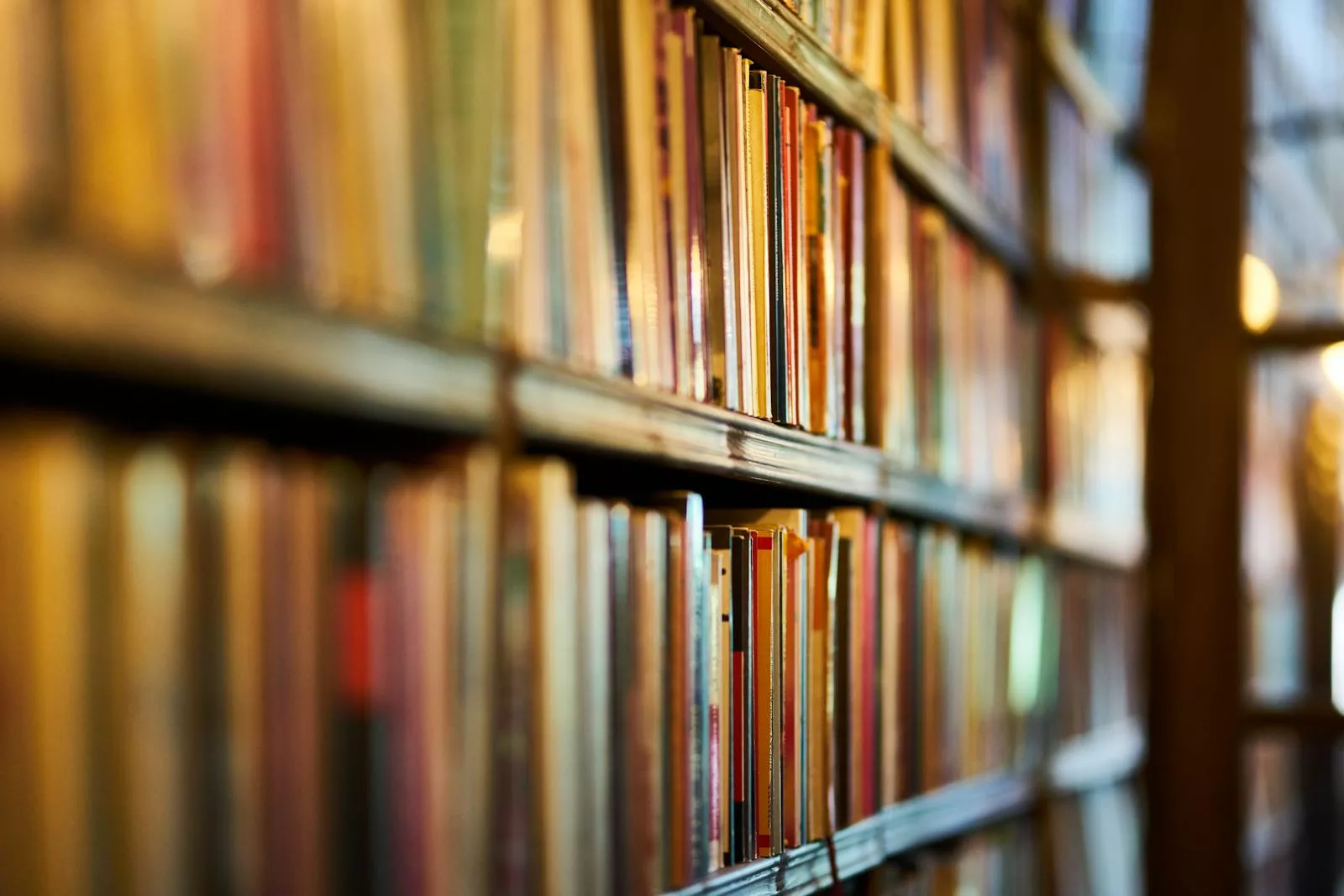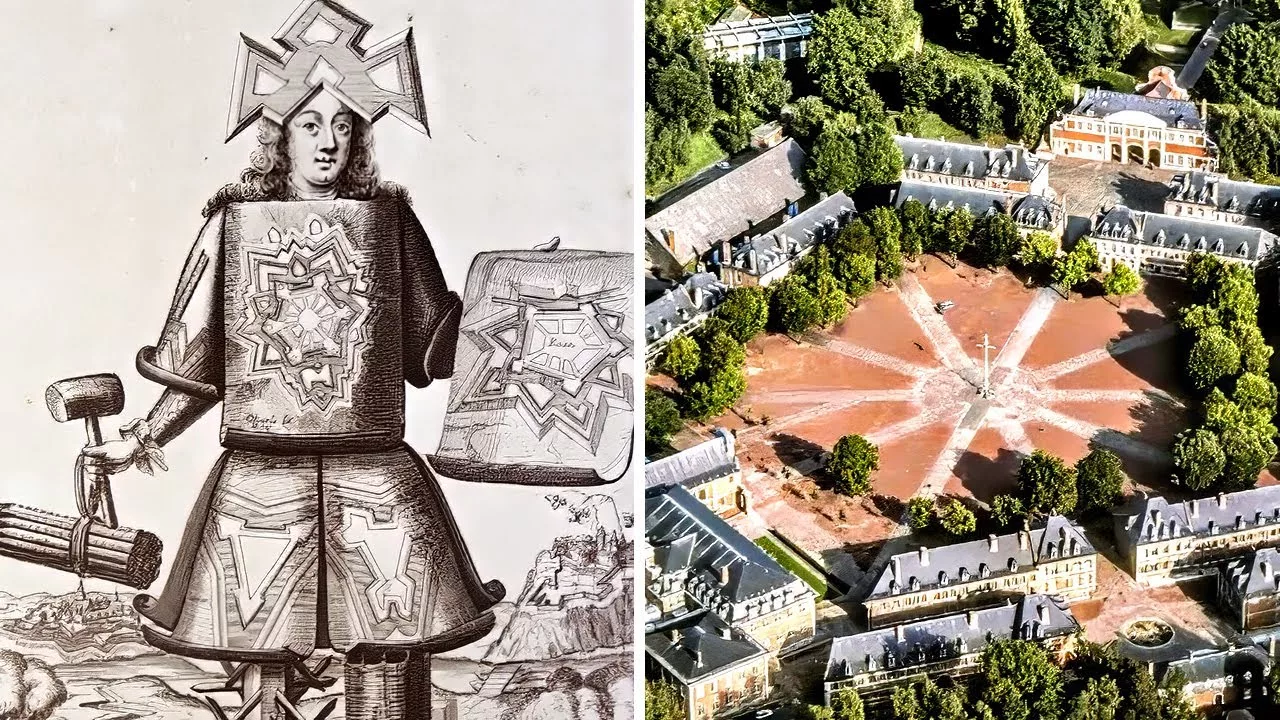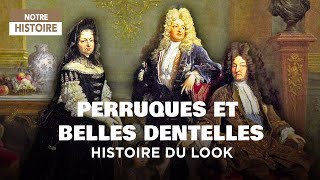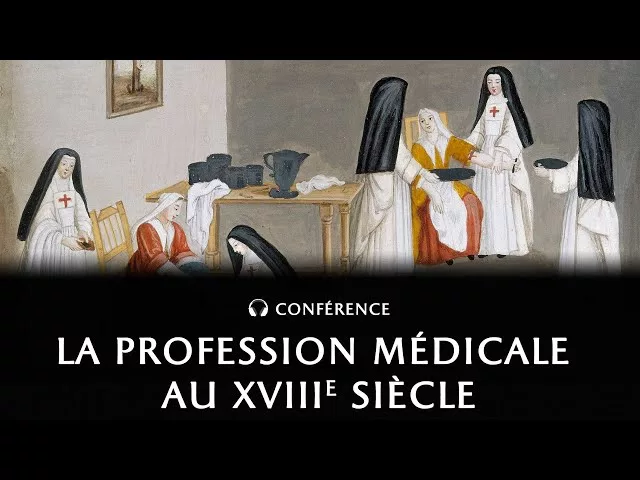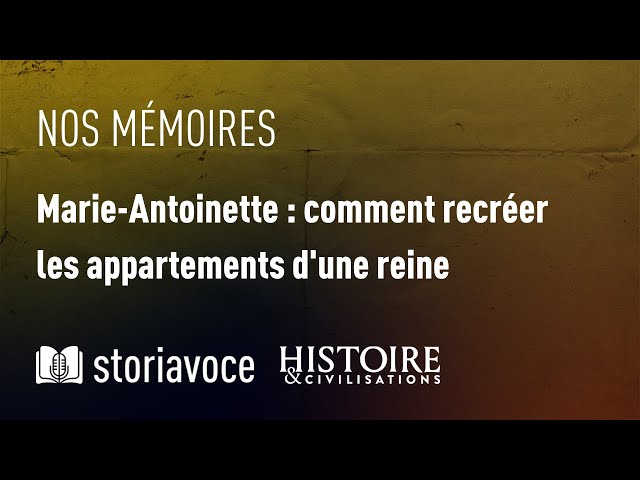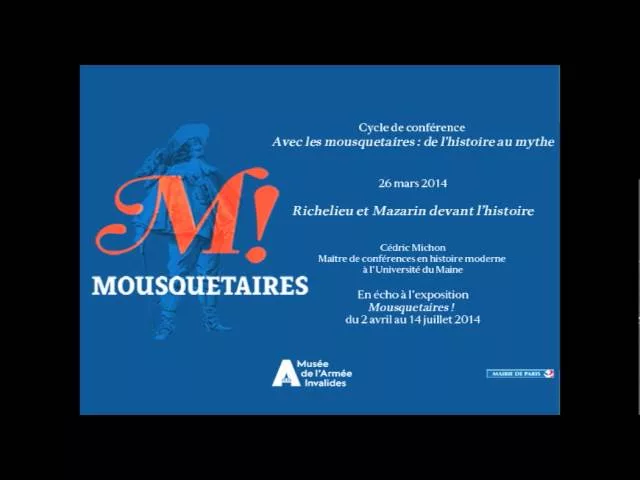Entré dès l’âge de dix-neuf ans au service de la Compagnie des Indes, Bertrand Mahé de La Bourdonnais ne tarde pas à se distinguer par ses qualités maritimes, son sens stratégique et son audace.
En 1735, il accède à un poste prestigieux en devenant gouverneur des îles de France (aujourd’hui l’île Maurice) et de Bourbon (actuelle La Réunion). Ambitieux et visionnaire, il souhaite ardemment étendre l’influence française au-delà de l’océan Indien.
Dès lors, son regard se tourne vers la Malaisie et les îles de la Sonde, territoires prometteurs mais encore hors d’atteinte pour la France.
Un rêve d’expansion contrarié
Bien qu’animé d’un souffle conquérant, La Bourdonnais ne peut compter que sur lui-même. La France, préoccupée par d’autres enjeux géopolitiques, refuse de lui accorder son soutien officiel.
Loin de se laisser décourager, il décide alors de financer lui-même une escadre navale pour mener ses opérations, démontrant un courage et une détermination hors du commun.
« L’abandon d’un empire en germe naît parfois de l’aveuglement des puissants. »
Il engage alors ses propres ressources dans cette entreprise risquée, mettant sur pied une flotte privée et rassemblant autour de lui des hommes aussi téméraires que fidèles. Loin des salons de Versailles, La Bourdonnais incarne l’audace d’un empire colonial encore à bâtir.
Des victoires éclatantes en Inde
Sa flotte croise bientôt les navires britanniques au large des côtes indiennes. La confrontation est inévitable. Mais contre toute attente, La Bourdonnais mène ses forces à la victoire lors de la bataille de Negapattinam, infligeant une défaite retentissante aux Anglais.
Fort de cet exploit, il poursuit sa campagne et parvient à s’emparer de Madras, un comptoir stratégique contrôlé par la Couronne britannique.
- Prise de Madras : point clé de la domination anglaise
- Capitulation obtenue sans massacre
- Rançon de dix millions négociée pour sa restitution
- Réputation militaire de La Bourdonnais au sommet
Cependant, cette brillante réussite va paradoxalement précipiter sa chute, car elle ravive des jalousies politiques au sein même de l’administration française.
L’ombre de Dupleix
Au lieu d’être célébré comme un héros, La Bourdonnais devient la cible de Dupleix, alors gouverneur général des colonies françaises en Inde.
Ce dernier, craignant sans doute l’influence croissante de son rival, conteste l’accord de rançon passé avec les Anglais, sous prétexte que Madras aurait dû être conservée.
« En Inde, les ennemis de La Bourdonnais ne parlaient pas tous anglais. »
Ce désaveu public provoque une crise diplomatique, mais surtout une rupture profonde entre les deux hommes. Dupleix manœuvre habilement pour accuser La Bourdonnais de trahison, l’accablant de responsabilités qui n’étaient pas les siennes. La rivalité devient personnelle et politique à la fois.
L’humiliation du retour
De retour en France après un voyage périlleux, La Bourdonnais espère se justifier devant la Compagnie des Indes. Mais le climat lui est hostile : la campagne de diffamation orchestrée par Dupleix a déjà empoisonné les esprits.
Très vite, le marin se retrouve isolé, ses alliés l’ayant abandonné face à une cabale montante.
- Isolement politique complet
- Soutiens disparus dans les cercles parisiens
- Procès différé à plusieurs reprises
- Rumeurs de corruption habilement diffusées
L’injustice est flagrante : La Bourdonnais est enfermé à la Bastille sans avoir pu défendre sa cause. On refuse même de l’entendre, comme si son destin devait se solder dans le silence et l’oubli.
L’acquittement trop tardif
Ce n’est qu’après deux longues années de détention que la justice consent enfin à lui accorder un procès. Lors de sa comparution, les faits sont réexaminés, et les accusations s’effondrent. Il est formellement acquitté.
Pourtant, le temps a fait son œuvre : malade, affaibli par des conditions d’incarcération éprouvantes, La Bourdonnais sort de prison dans un état lamentable.
« Parfois, l’honneur retrouvé n’efface pas les blessures du corps et de l’âme. »
Il n’aura guère le temps de savourer sa réhabilitation. Le 10 novembre 1753, Bertrand Mahé de La Bourdonnais s’éteint, miné par les infirmités contractées en prison. Il meurt dans l’indifférence générale, loin de la gloire qu’il aurait dû connaître.
Conclusion : une figure méconnue de l’épopée coloniale française
Le destin de La Bourdonnais illustre les paradoxes de l’histoire coloniale française : celui d’un homme brillant, audacieux, capable de bâtir un empire à lui seul, mais broyé par les rivalités politiques et les jeux de pouvoir.
Victime de son succès et des manigances d’un rival plus rusé que courageux, il reste aujourd’hui une figure trop souvent oubliée.