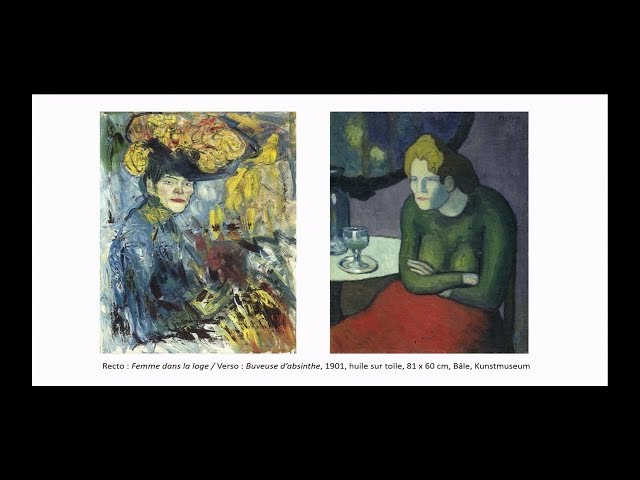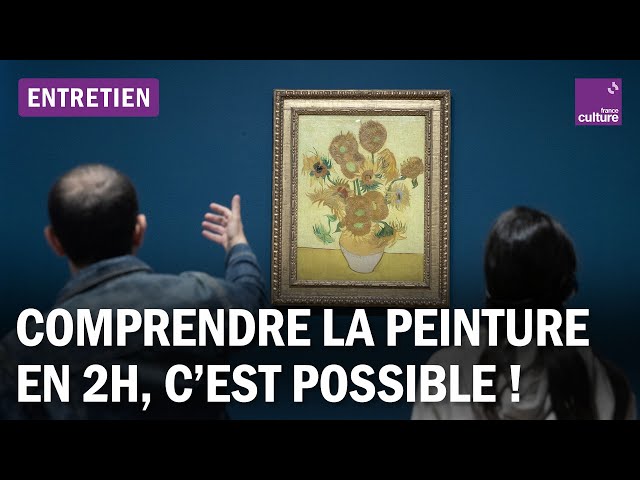On connaît Géricault pour ses peintures de chevaux transis par la foudre, pour ses portraits d’enfants les plus troublants de l’art français, pour ses têtes de fous qui n’ont aucun équivalent dans l’histoire de la peinture, et pour son immense tableau révolutionnaire, Le Radeau de la Méduse, chef-d’œuvre du Romantisme, protestation de la vie jusque dans la mort. On sait aussi que son existence fut brève et fulgurante, son œuvre inachevée et inspirée, et que sa mémoire fut révérée par tous les artistes du XIXe siècle. Mais à la faveur du renouveau des études sur ce peintre, on peut montrer maintenant que Géricault fut en outre un penseur, aussi grand qu’il fut grand artiste ; et on peut postuler à titre d’hypothèse herméneutique que sa pensée fut une généalogie de la peinture.
On découvre d’abord dans ses premiers ouvrages de 1808 à 1814 son premier tourment qui fut de questionner la différence entre l’homme et l’animal, son travail se définissant alors comme conscience de soi de la peinture, où l’existence humaine sort de la vie par la représentation. Ensuite, de 1814 à 1817, en particulier dans les études exécutées en Italie, on voit que l’artiste remonte jusqu’au fondement de la représentation dans la violence Puis l’analyse du tableau de 1819, Le Radeau de la Méduse, révèle que sa généalogie de la peinture s’y parachève, exhibant dans la vie originaire la provenance de la violence.
Au cours des années d’avant sa mort en 1824, éclate enfin la force la plus audacieuse dont le peintre fut doué – la force de la compassion –, qui fait la beauté irrésistible de ses lithographies, de ses portraits et de ses études de tête, où, abaissant son art, il en a réalisé la possibilité la plus féconde, témoignant de la présence d’autrui et de la transcendance de cette présence par rapport à toute image. Ainsi se manifeste l’unité profonde de l’œuvre entière de Géricault : connaissance de soi, critique de la violence, affirmation de la vie et lucidité de la compassion.