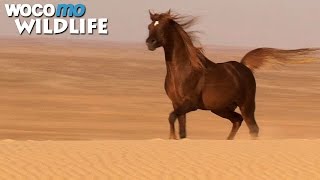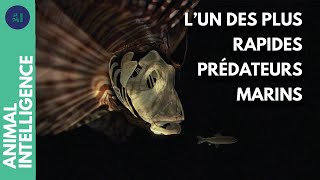L’intelligence artificielle (IA), longtemps confinée aux romans de science-fiction, est désormais une composante incontournable de notre quotidien. Aujourd’hui, elle est présente dans une multitude de domaines : des assistants vocaux aux systèmes de recommandation, en passant par les diagnostics médicaux assistés par ordinateur ou encore les véhicules autonomes. Cette omniprésence s’explique par sa capacité à analyser des quantités colossales de données, à reconnaître des schémas complexes et à apprendre de manière autonome grâce à des algorithmes d’apprentissage profond. L’IA ne se contente plus d’exécuter des tâches répétitives ; elle acquiert une forme de raisonnement, elle anticipe, elle s’adapte, parfois même mieux que l’humain dans des contextes spécifiques.
Cependant, malgré ces prouesses, l’IA reste aujourd’hui fondamentalement dépendante de l’humain : elle n’a pas de conscience, pas de sens moral, et son intelligence reste spécialisée. Elle peut exceller dans un jeu d’échecs ou dans la traduction automatique, mais elle demeure incapable de généraliser ses compétences à des contextes très éloignés. Les systèmes actuels sont souvent biaisés par les données sur lesquelles ils ont été entraînés, et leurs décisions manquent parfois de transparence. C’est ici que se pose une question cruciale : quelle place voulons-nous donner à l’IA dans notre société ?