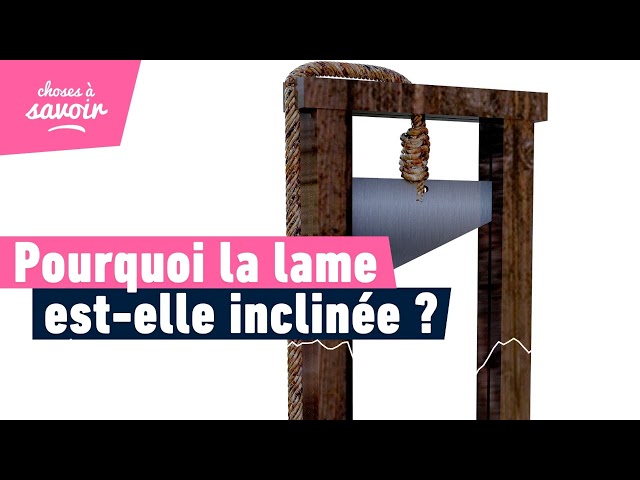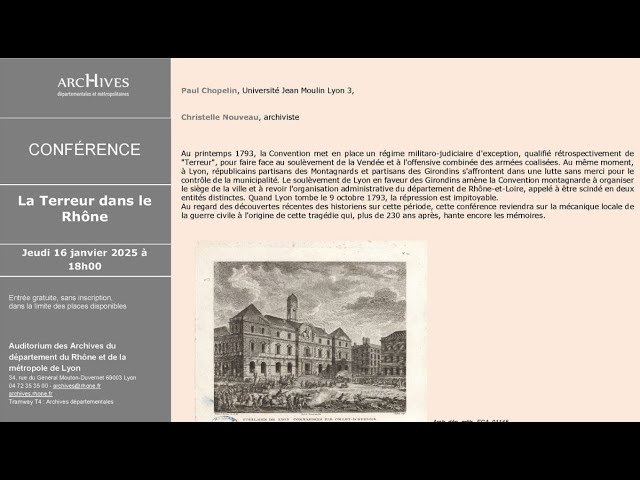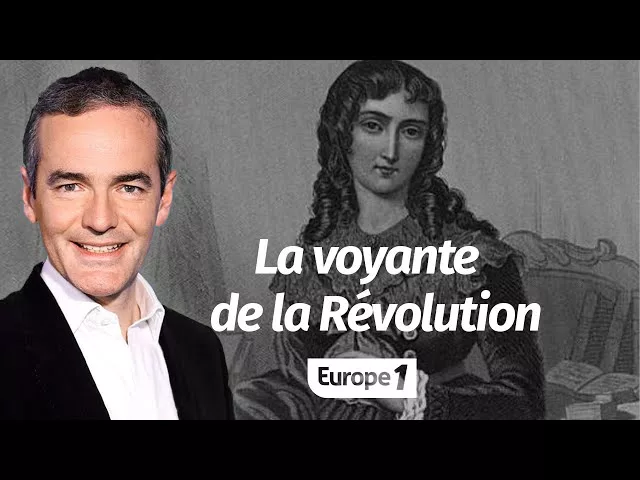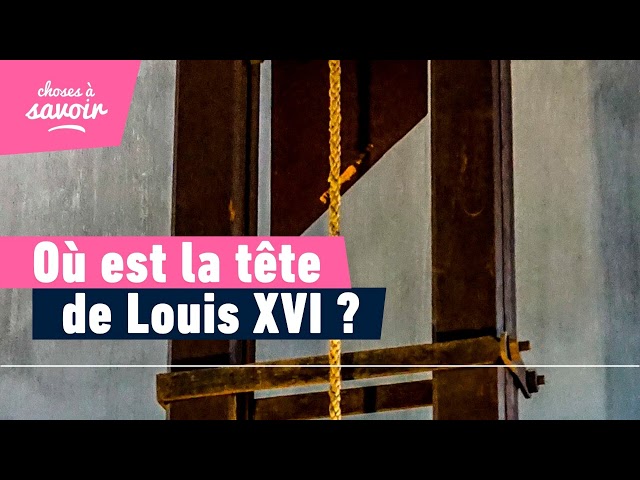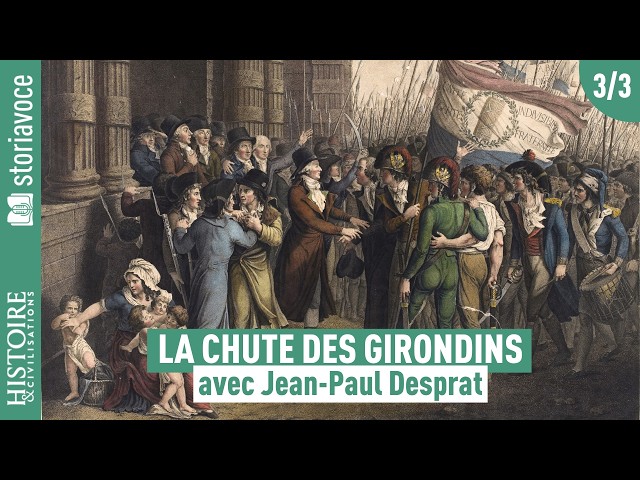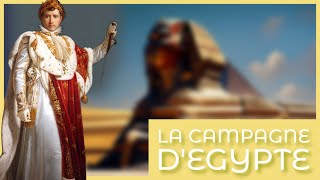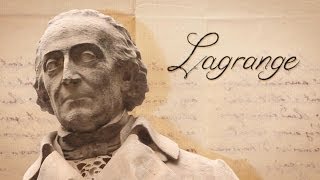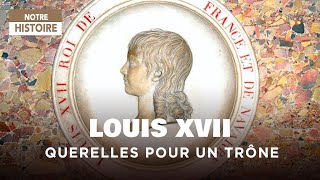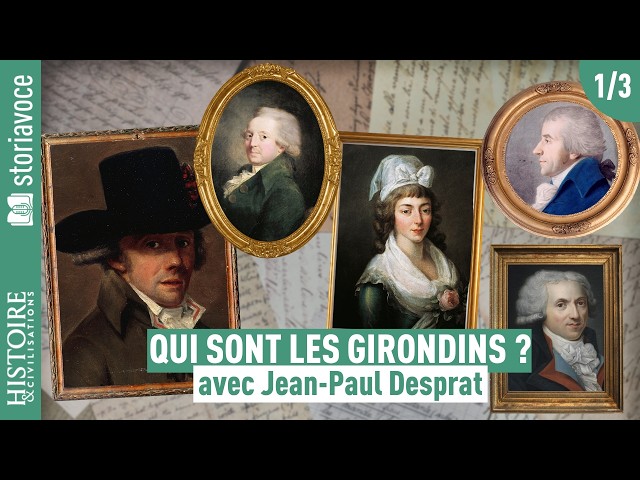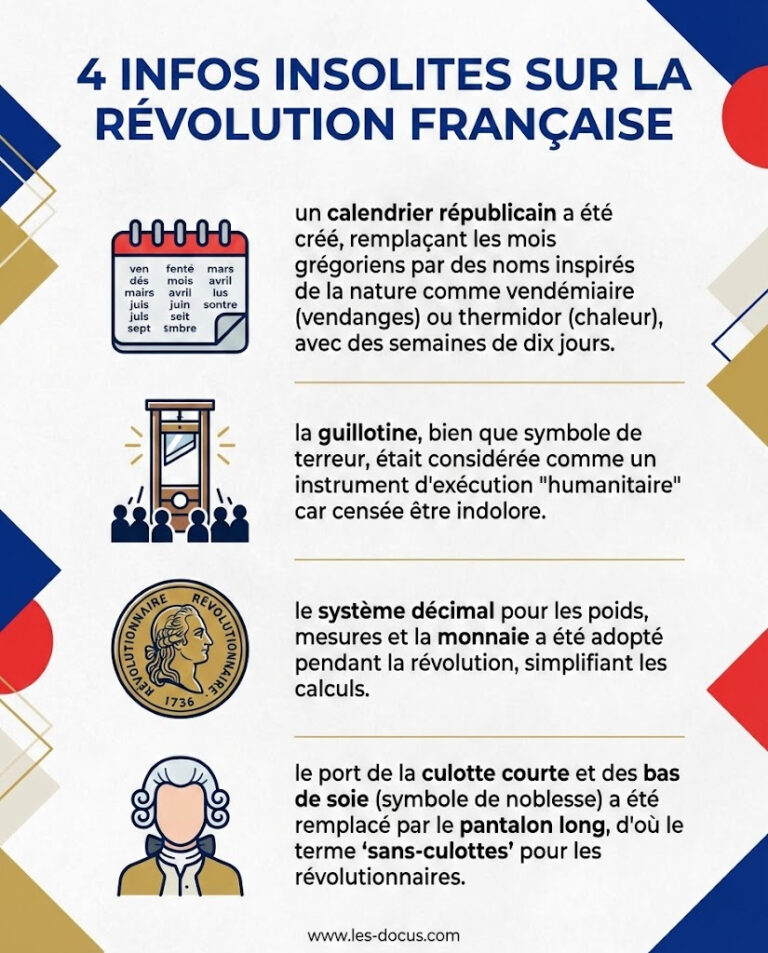
La Révolution française ne fut pas seulement une tempête politique ou une succession de batailles héroïques et sanglantes. Ce fut avant tout une tentative radicale, presque démiurgique, de réinitialiser la civilisation elle-même.
En l’espace de quelques années, les révolutionnaires ont cherché à effacer des millénaires de traditions pour bâtir un monde nouveau, fondé sur la Raison et la Nature. Cette volonté de régénération totale a touché les aspects les plus triviaux comme les plus fondamentaux de l’existence humaine, du vêtement que l’on porte à la manière dont on mesure le temps qui passe.
Au-delà des grandes figures de Robespierre ou de Danton, l’histoire de cette période regorge d’anecdotes insolites qui révèlent l’état d’esprit d’une époque où tout semblait possible. Ces quatre faits, souvent résumés à de simples notes de bas de page, sont en réalité des fenêtres ouvertes sur l’âme de la Révolution.
Résumé des points abordés
Une nouvelle horloge pour l’humanité
L’une des entreprises les plus audacieuses de la Convention nationale fut sans doute la réforme du temps lui-même. Il ne s’agissait pas simplement de changer de calendrier, mais de rompre définitivement avec le passé religieux de la France et le rythme imposé par l’Église catholique depuis des siècles.
Le calendrier grégorien, avec ses saints, ses dimanches et ses références bibliques, était perçu comme un outil d’asservissement intellectuel. Pour les républicains, le temps ne devait plus appartenir à Dieu, mais à la Nature et à la République.
C’est ainsi qu’est né le calendrier républicain, entré en vigueur en octobre 1793 mais débutant rétroactivement le 22 septembre 1792, date de la proclamation de la République et jour de l’équinoxe d’automne. L’année ne commençait plus au cœur de l’hiver, mais à un moment d’équilibre astronomique, symbolisant l’égalité du jour et de la nuit.
L’année fut découpée de manière purement mathématique : douze mois de trente jours rigoureusement identiques. Pour combler l’écart avec l’année solaire de 365 jours, on ajouta cinq jours (six les années bissextiles) à la fin de l’année.
Ces jours hors-normes furent baptisés les « Sans-culottides », consacrés à la Vertu, au Génie, au Travail, à l’Opinion et aux Récompenses. C’était une manière d’instaurer des fêtes laïques célébrant les valeurs citoyennes plutôt que des miracles religieux.
Mais le plus grand changement résidait dans la structure de la semaine. La semaine de sept jours, héritage de la Genèse biblique, fut abolie au profit de la « décade », une période de dix jours.
Ce système décimal, jugé plus rationnel, avait un défaut majeur pour la classe ouvrière. Sous l’Ancien Régime, le dimanche offrait un jour de repos tous les sept jours.
Avec la décade, le jour de repos, le « décadi », n’intervenait plus que tous les dix jours. Cette rationalisation du temps fut vécue comme une augmentation brutale de la charge de travail, créant une impopularité sourde au sein du peuple que la Révolution prétendait défendre.
L’aspect le plus poétique de cette réforme demeure la nomenclature des mois, imaginée par le poète Fabre d’Églantine. Il refusa les noms de dieux romains ou d’empereurs (Mars, Auguste, Juillet) pour puiser dans le terroir français.
Les mois d’automne devinrent Vendémiaire (les vendanges), Brumaire (les brumes), Frimaire (le froid). L’hiver nous donna Nivôse (la neige), Pluviôse (la pluie), Ventôse (le vent).
Le printemps vit éclore Germinal (la germination), Floréal (les fleurs), Prairial (les prairies). Enfin, l’été se déclina en Messidor (les moissons), Thermidor (la chaleur) et Fructidor (les fruits).
Cette poésie agricole ancrait la Révolution dans la terre de France, mais elle souffrait d’un défaut d’universalité. Ces noms n’avaient de sens que dans l’hémisphère nord et sous un climat tempéré, ce qui contredisait la vocation universelle du message révolutionnaire.
La réforme tenta même d’imposer l’heure décimale. La journée fut divisée en 10 heures, chaque heure en 100 minutes, et chaque minute en 100 secondes.
Des horloges furent fabriquées pour afficher ce nouveau temps, mais la confusion fut telle que cette partie de la réforme fut abandonnée après seulement six mois. Le calendrier, lui, survécut jusqu’en 1806, date à laquelle Napoléon, cherchant à se rapprocher de l’Église et à faciliter les relations internationales, le jeta aux oubliettes de l’histoire.
La machine philanthropique du docteur guillotin
L’image de la guillotine est aujourd’hui indissociable de la Terreur, du sang versé et de la tyrannie de la foule. Pourtant, à son origine, elle fut conçue et défendue comme un progrès humanitaire majeur, une victoire de la philosophie des Lumières sur la barbarie médiévale.
Sous l’Ancien Régime, la mort donnée par la justice était un spectacle cruel et, surtout, profondément inégalitaire. La méthode d’exécution dépendait directement du rang social du condamné et de la nature de son crime.
Les nobles avaient le privilège d’être décapités à l’épée ou à la hache, une mort considérée comme honorable et relativement rapide si le bourreau était adroit. Les roturiers, eux, étaient pendus, une agonie lente et humiliante.
Pour les crimes jugés plus graves, comme le régicide ou le parricide, l’horreur n’avait pas de limite. On pratiquait le supplice de la roue, où le condamné avait les membres brisés à coups de barre de fer avant d’être exposé vivant, ou l’écartèlement, comme ce fut le cas pour Damiens en 1757.
C’est contre ces atrocités que s’éleva le docteur Joseph-Ignace Guillotin, député de Paris, en 1789. Cet homme, médecin humaniste et philanthrope, n’a paradoxalement pas inventé la machine qui porte son nom, mais il en a théorisé la nécessité morale.
Son argumentaire reposait sur deux piliers : l’égalité et l’absence de souffrance. Il proclama devant l’Assemblée que « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Il fallait donc un mode d’exécution unique, quel que soit le statut du coupable. De plus, la société ayant le droit de reprendre la vie mais pas celui de faire souffrir, la mort devait être instantanée.
Guillotin décrivit son projet avec une phrase restée célèbre, bien que maladroite, promettant que le condamné ne sentirait qu’une « légère fraîcheur sur le cou ». La mise au point technique de la machine fut confiée au chirurgien Antoine Louis, d’où son premier surnom de « Louison », et réalisée par un facteur de piano allemand, Tobias Schmidt.
Lorsque la guillotine entra en service en avril 1792, lors de l’exécution du voleur Nicolas Jacques Pelletier, la réaction du public fut surprenante. La foule parisienne, habituée aux supplices longs et théâtraux de l’Ancien Régime, se sentit flouée par la rapidité du procédé.
Il n’y avait pas de spectacle, pas de cris, pas de lutte : en une fraction de seconde, c’était terminé. Des chansonniers de l’époque se moquèrent même de cette machine trop efficace qui « enlevait le goût » à l’exécution publique.
Cependant, cette efficacité industrielle allait bientôt servir une cause bien plus sombre. Ce qui avait été conçu pour humaniser la justice permit, techniquement, l’exécution de masse.
La rapidité du mécanisme rendit possible les cadences infernales de la Terreur, où des dizaines de personnes pouvaient être exécutées en une seule matinée. Le docteur Guillotin, emprisonné un temps sous la Terreur, survécut à la Révolution mais passa le reste de sa vie à déplorer que son nom soit associé à l’instrument de mort, alors qu’il ne cherchait qu’à adoucir la fin de vie des condamnés.
Il est fascinant de noter que la guillotine est restée le mode d’exécution officiel en France jusqu’à l’abolition de la peine de mort en 1981. Ce qui était une « nouveauté insolite » de 1789 est devenu, pendant près de deux siècles, la norme judiciaire française, validant ironiquement l’argument d’efficacité de ses promoteurs.
Le mètre ou la conquête de l’universalité
Si le calendrier républicain a échoué et si la guillotine est devenue un symbole d’infamie, la troisième grande innovation de cette époque a conquis le monde entier : le système métrique. C’est sans doute l’héritage le plus tangible et le plus quotidien de la Révolution française.
Avant 1789, la France, comme le reste du monde, était un chaos métrologique absolu. On estime qu’il existait plus de 800 noms de mesures différentes et, pire encore, jusqu’à 250 000 valeurs différentes pour ces mesures à travers le royaume.
Un « pied » à Paris n’avait pas la même longueur qu’un « pied » à Strasbourg. Une « pinte » de vin versée à Marseille n’avait pas le même volume qu’à Lille.
Cette disparité n’était pas seulement un casse-tête pour les savants ; c’était un frein majeur au commerce et une source constante de fraudes. Les seigneurs locaux pouvaient modifier les étalons de mesure pour prélever plus d’impôts en nature, abusant ainsi des paysans.
Dans les cahiers de doléances de 1789, la demande « d’un seul Roi, une seule loi, un seul poids et une seule mesure » revenait de manière récurrente. Les révolutionnaires, guidés par l’esprit des Lumières, décidèrent de créer un système qui ne dépendrait pas de l’arbitraire d’un homme, fût-il roi, mais d’une réalité physique inaltérable.
Condorcet résuma cette ambition par une formule célèbre : le nouveau système devait être « pour tous les temps, pour tous les peuples ». Il ne fallait pas baser le mètre sur la longueur du pied de Charlemagne, mais sur la taille de la Terre elle-même.
L’Académie des sciences définit alors le mètre comme étant la dix-millillonième partie du quart du méridien terrestre. Pour concrétiser cette définition théorique, une épopée scientifique digne d’un roman d’aventures fut lancée en 1792.
Deux astronomes, Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain, furent chargés de mesurer la distance exacte entre Dunkerque et Barcelone pour extrapoler la circonférence de la Terre. Leur mission dura sept ans et fut semée d’embûches incroyables.
Ils durent grimper sur des clochers et des sommets de montagnes avec leurs instruments de précision, en pleine guerre civile et étrangère. Tantôt arrêtés comme espions royalistes par des révolutionnaires zélés parce qu’ils utilisaient des instruments bizarres, tantôt bloqués par les armées ennemies, ils persistèrent malgré le froid, la maladie et le découragement.
Méchain, perfectionniste tourmenté, faillit même devenir fou en découvrant une erreur dans ses calculs. De leurs travaux naquit le mètre étalon en platine, déposé aux Archives nationales.
Le système décimal qui l’accompagnait (kilo, litre, centimètre) simplifiait radicalement les calculs par rapport au système duodécimal (base 12) ou aux systèmes complexes britanniques. Bien que les Français aient mis du temps à s’adapter, continuant par habitude à parler en livres ou en toises pendant des décennies, la logique implacable du système métrique a fini par s’imposer.
Il a facilité la révolution industrielle, les échanges internationaux et la communication scientifique. Aujourd’hui, à l’exception notable des États-Unis (et de deux autres petits pays), l’humanité entière utilise le langage de mesure inventé par les savants de la Révolution française, réalisant ainsi le rêve d’universalité de 1789.
Le pantalon : un manifeste politique en tissu
La dernière insolite concerne l’apparence. Dans l’histoire, il est rare qu’un vêtement devienne l’emblème d’un régime politique, mais c’est exactement ce qui s’est passé avec le pantalon lors de la Révolution française.
Pour comprendre l’impact de ce changement, il faut visualiser la mode masculine du XVIIIe siècle. L’aristocratie et la haute bourgeoisie portaient la « culotte », un vêtement ajusté s’arrêtant juste au-dessous du genou, complété par des bas de soie, souvent blancs, qui moulaient le mollet.
Ce costume était un marqueur de classe extrêmement fort. Il signifiait que l’on ne travaillait pas de ses mains, que l’on vivait dans les salons et à la cour.
Les bas de soie étaient fragiles, salissants et inadaptés au labeur physique. À l’inverse, le peuple, les artisans, les marins et les ouvriers portaient le « pantalon » long, souvent en toile grossière ou à rayures, qui descendait jusqu’aux chevilles.
C’était le vêtement du travail, pratique et robuste. Lorsque la Révolution s’est radicalisée, à partir de 1792, le vêtement est devenu un moyen d’afficher ses convictions politiques.
Les militants les plus fervents, ceux qui réclamaient l’égalité réelle et la démocratie directe, ont rejeté la culotte aristocratique pour adopter le pantalon du travailleur. C’est ainsi qu’est né le terme « Sans-culottes ».
Contrairement à ce que l’expression pourrait suggérer de manière humoristique, ils ne se promenaient pas les jambes nues. Ils étaient « sans culotte » parce qu’ils portaient des pantalons.
Ce nom, d’abord utilisé comme une insulte par les aristocrates pour moquer la pauvreté des révolutionnaires, a été revendiqué avec fierté. Le costume du sans-culotte devint un uniforme politique codifié : le pantalon long (souvent rayé bleu et blanc), la carmagnole (une veste courte), et le fameux bonnet phrygien rouge orné de la cocarde tricolore.
Porter ce vêtement, c’était rejeter les hiérarchies de l’Ancien Régime et s’affirmer comme membre du peuple souverain. C’était aussi un outil d’intimidation.
Dans les rues de Paris, un homme portant des bas de soie et une culotte poudrée devenait immédiatement suspect. Il affichait une nostalgie pour le monde d’avant et risquait l’insulte, l’arrestation, voire pire.
Par mimétisme ou par instinct de survie, de nombreux bourgeois se mirent à porter le pantalon pour donner des gages de civisme. Ce phénomène marqua le début de la grande renonciation masculine en matière de mode.
Avant la Révolution, les hommes de pouvoir portaient des talons, des couleurs vives, des dentelles et du maquillage. La figure du Sans-culotte a imposé une esthétique de la sobriété et de l’austérité virile.
Bien que la mode « Sans-culotte » stricte se soit effacée avec la chute de Robespierre, la culotte courte ne revint jamais vraiment en grâce dans le vestiaire masculin quotidien. Le pantalon s’imposa définitivement au XIXe siècle comme le standard universel masculin, symbole de l’ère bourgeoise et industrielle.
Le costume-cravate que portent les hommes d’affaires aujourd’hui est l’héritier lointain, bien que très embourgeoisé, de cette révolution vestimentaire. Ainsi, chaque homme qui enfile un pantalon ce matin rend, sans le savoir, un hommage inconscient aux artisans parisiens de 1793 qui décidèrent un jour que la noblesse des genoux n’avait plus lieu d’être.