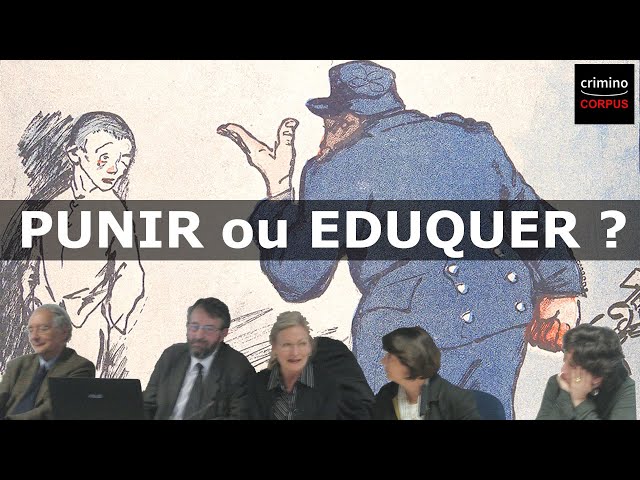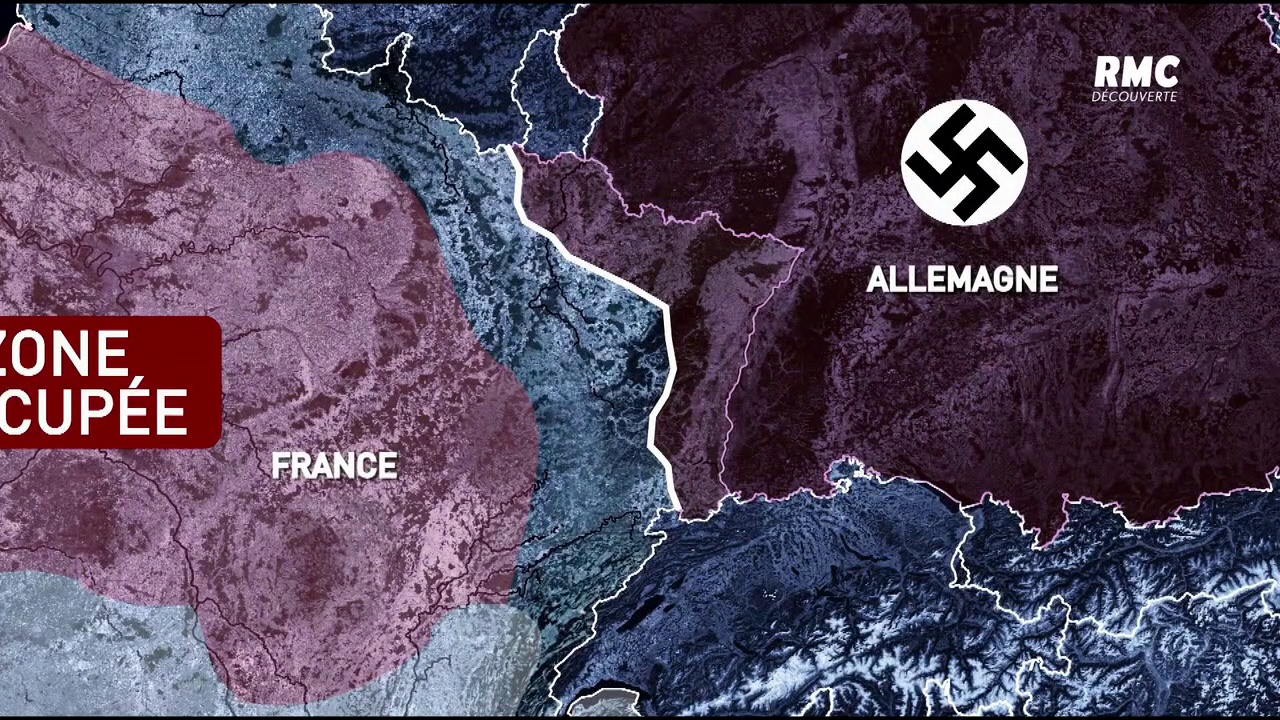L’homme du 18 juin, le fondateur de la Ve République, le « Connétable »… Charles de Gaulle est une figure tellement immense de l’Histoire de France qu’il en est presque devenu une statue de pierre avant même de nous quitter.
Pourtant, derrière le mythe, l’uniforme et la rhétorique impeccable, se cachait un homme aux caractéristiques singulières, dont le parcours fut parsemé d’anecdotes révélatrices de son tempérament d’acier.
Résumé des points abordés
Une stature hors norme pour un destin unique
Dès ses jeunes années, Charles de Gaulle ne passe pas inaperçu. Il y a chez lui une présence physique qui impose, littéralement, le respect ou l’agacement.
Avec son mètre quatre-vingt-treize (1m93), il domine de la tête et des épaules la quasi-totalité de sa génération. Il faut se rappeler qu’au début du XXe siècle, la taille moyenne des hommes français peinait à dépasser 1m66. De Gaulle n’est pas seulement grand ; il est gigantesque pour son époque.
Cette particularité physique lui vaudra, lors de son passage à l’école militaire de Saint-Cyr en 1909, des surnoms aussi moqueurs qu’affectueux. Ses camarades, obligés de lever la tête pour lui parler, le baptisent rapidement la « Grande Asperge ». D’autres préfèrent l’appeler « Double-mètre » ou, plus poétiquement, le « Coq », en référence à son profil et à son nez proéminent qui semblait fendre l’air.
Mais cette taille n’est pas qu’un détail anatomique. Elle a forgé sa psychologie. Habitué à voir le monde d’en haut, contraint de se pencher pour écouter, il développe une forme de distance naturelle, une solitude physique qui préfigure sa solitude politique.
On raconte même que cette stature posait des problèmes logistiques constants : trouver un uniforme adapté, un lit assez long ou des chaussures à sa taille – il chaussait un impressionnant 47 – relevait parfois du défi.
Cette singularité corporelle deviendra plus tard un atout politique indéniable. Dans les foules, lors de la Libération de Paris ou de ses bains de foule en province, on ne voyait que lui. Il était le point de repère, le phare au milieu de la marée humaine.
Sa stature physique a fini par épouser parfaitement sa stature historique, comme si la nature l’avait prédestiné à dépasser la norme.
L’obstination farouche du prisonnier de guerre
On oublie souvent que le grand chef de guerre de la Seconde Guerre mondiale a passé la moitié de la Première derrière les barreaux. Le capitaine de Gaulle n’a pas vécu l’armistice de 1918 dans la liesse des tranchées, mais dans l’amertume d’une cellule allemande.
Capturé à Douaumont, près de Verdun, en mars 1916 après avoir été blessé et laissé pour mort, il entame une période sombre qui durera 32 mois.
Pour un officier de sa trempe, pétri de patriotisme et d’envie d’en découdre, la captivité est une humiliation insupportable, une « lamentable oisiveté » comme il l’écrira. Mais c’est justement dans cette épreuve que se révèle son caractère indomptable. Loin de se résigner à attendre la fin du conflit en jouant aux cartes, de Gaulle devient un évadé obsessionnel.
Il ne tentera pas de s’échapper une fois, ni deux, mais à cinq reprises.
L’imagination qu’il déploie pour retrouver la liberté force l’admiration : il creuse des trous dans les murailles, tente de scier les barreaux, et va jusqu’à avaler des substances pour provoquer des jaunisses factices afin d’être transféré dans des hôpitaux moins surveillés. Il se déguise, vole des uniformes, mais à chaque fois, sa taille immense le trahit ou la malchance s’en mêle.
Ces tentatives répétées lui valent d’être classé comme prisonnier « difficile » et transféré à la forteresse d’Ingolstadt, en Bavière. C’est un camp de représailles, une véritable prison de haute sécurité où les Allemands regroupent les officiers les plus récalcitrants. Il y côtoie l’élite des prisonniers alliés, dont le futur maréchal soviétique Mikhaïl Toukhatchevski.
C’est entre ces murs, paradoxalement, que de Gaulle parfait sa formation intellectuelle. Il lit énormément, apprend l’allemand pour lire la presse ennemie et comprendre la psychologie de l’adversaire. Ces cinq évasions ratées sont peut-être ses premiers actes de résistance concrète : le refus absolu de la soumission, même lorsque la situation semble désespérée. Une leçon qu’il n’oubliera pas vingt ans plus tard.
Le condamné à mort par contumace
L’histoire retient le 18 juin 1940 comme l’acte de naissance de la Résistance. Mais juridiquement, pour l’État français de l’époque, cet acte est un crime.
La bascule est vertigineuse : en quelques semaines, le sous-secrétaire d’État à la Guerre devient un paria. Alors que le Maréchal Pétain serre la main d’Hitler à Montoire, la machine judiciaire de Vichy se met en branle pour briser le général rebelle.
La sentence tombe au cœur de l’été, le 2 août 1940. Le tribunal militaire permanent de la 13e région, siégeant à Clermont-Ferrand, rend son verdict. Charles de Gaulle est reconnu coupable de trahison, d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État et de désertion à l’étranger en temps de guerre. La sanction est la plus lourde prévue par le code de justice militaire : la peine de mort.
Le jugement ne s’arrête pas là. Il est assorti de la dégradation militaire – une infamie pour cet homme dont la vie est dédiée à l’armée – et de la confiscation de tous ses biens meubles et immeubles. De Gaulle, désormais à Londres, apprend la nouvelle. Loin de l’effrayer, cette condamnation semble le conforter dans sa légitimité.
Sa réaction est empreinte d’un mépris souverain. Il considère le jugement comme « nul et non avenu ». Son raisonnement est implacable : le gouvernement de Vichy, étant sous la botte de l’ennemi, n’a plus aucune légitimité juridique ou morale pour rendre la justice au nom du peuple français. « La trahison, c’est eux », pense-t-il.
Cette condamnation à mort crée une situation inédite et vertigineuse : le chef de la France Libre est officiellement un homme à abattre par sa propre patrie légale. Cela souligne l’immense prise de risque personnelle de son engagement.
S’il avait été capturé par les autorités de Vichy ou les Allemands, il aurait été fusillé sans autre forme de procès. Cette épée de Damoclès n’a fait que renforcer sa détermination à incarner la seule autorité légitime restante.
L’ultime leçon de modestie à colombey
Après avoir dirigé la France, tenu tête aux Alliés, fondé la Ve République et géré la crise de mai 68, on aurait pu imaginer pour Charles de Gaulle des funérailles grandioses, dignes des plus grands monarques ou de Napoléon.
L’État aurait volontiers organisé une descente des Champs-Élysées, une cérémonie au Panthéon ou aux Invalides. Mais l’homme avait prévu sa sortie de scène bien longtemps à l’avance, avec une précision testamentaire.
Dès 1952, soit dix-huit ans avant sa mort, il rédige ses dernières volontés. Le texte est d’une clarté tranchante. Il refuse catégoriquement les obsèques nationales. Il écrit : « Je ne veux ni président, ni ministres, ni bureau d’Assemblée, ni corps constitués ». Il refuse également toute musique, toute fanfare et tout discours.
À sa mort en novembre 1970, sa volonté est scrupuleusement respectée, créant un contraste saisissant qui marquera le monde entier. Alors qu’à Paris, sous les voûtes de la cathédrale Notre-Dame, les chefs d’État du monde entier (de Nixon à Podgorny) se réunissent pour une messe solennelle en son honneur, le corps du Général est ailleurs.
Il est dans son village de Colombey-les-Deux-Églises, transporté sur un engin blindé de reconnaissance (un EBR, sans tourelle) qui lui sert de corbillard, entouré seulement de sa famille, de ses voisins et de ses compagnons de l’Ordre de la Libération. C’est une cérémonie rurale, intime, presque austère.
Le détail le plus frappant reste sa pierre tombale. Il avait exigé qu’elle soit simple, sans épitaphe glorieuse, sans mention de ses titres de Président ou de Général, ni de ses faits d’armes. Sur le marbre blanc du cimetière communal, on peut lire uniquement : « Charles de Gaulle 1890-1970 ».
Ce dépouillement final est peut-être son message le plus puissant. En refusant les honneurs qu’il avait pourtant rétablis pour la France, il signifiait que l’homme n’était que de passage, serviteur d’une cause qui le dépassait.
Il voulait reposer terre à terre, parmi les Français anonymes, laissant l’Histoire se charger seule de sa gloire, sans artifices ni décorations. C’est là, dans ce petit cimetière de Haute-Marne, que le géant repose, finalement à taille humaine.