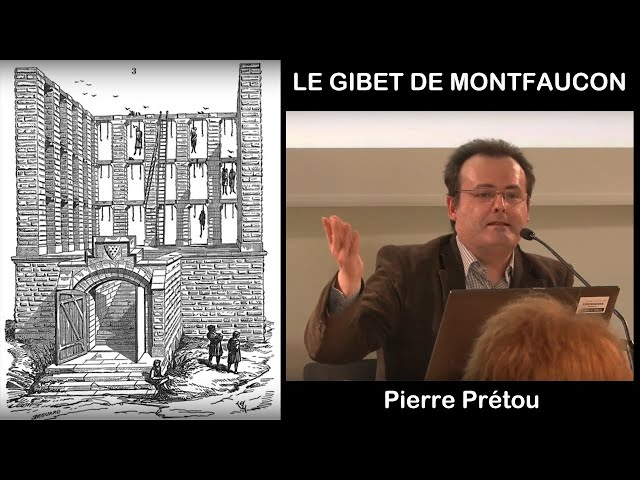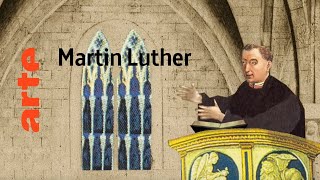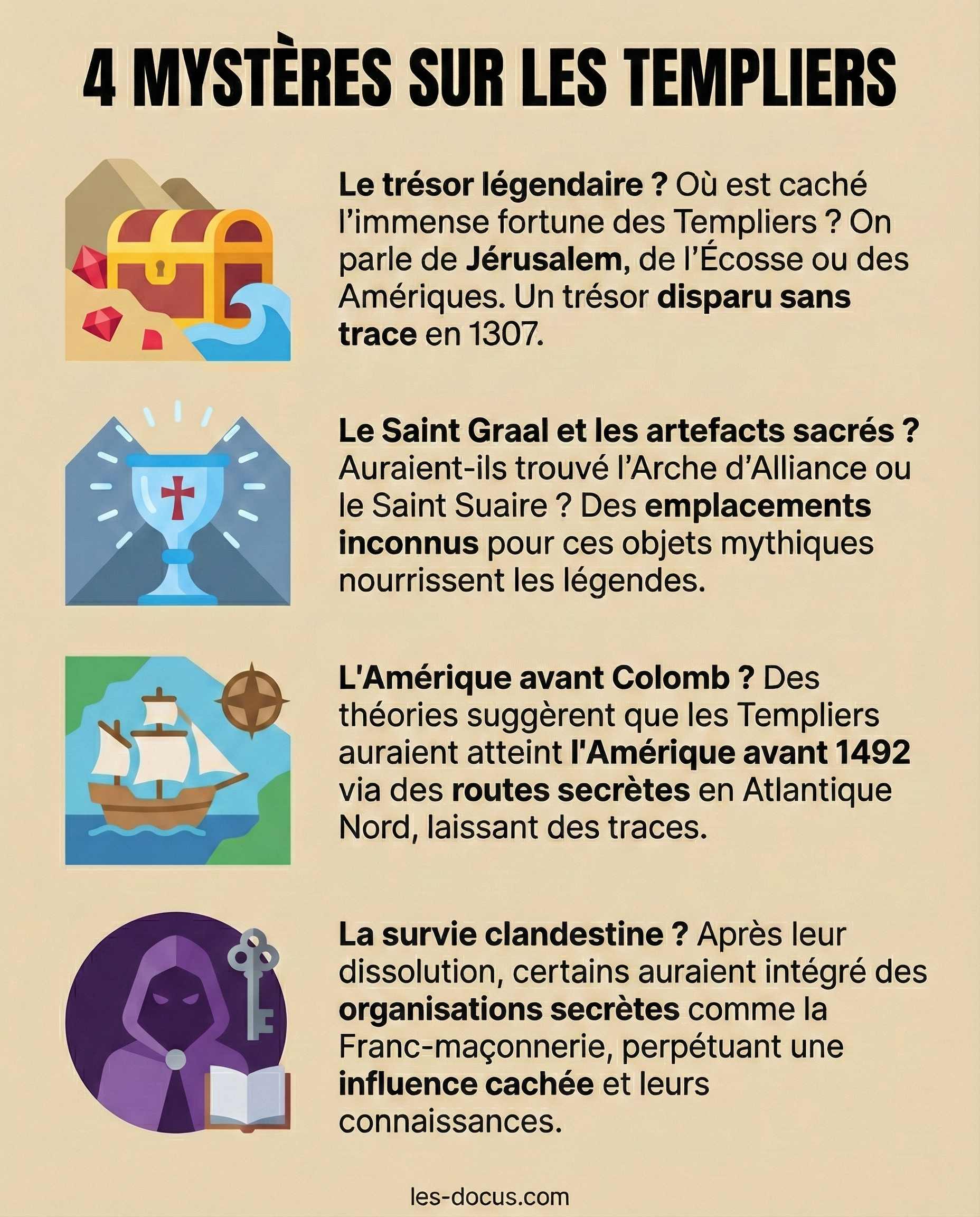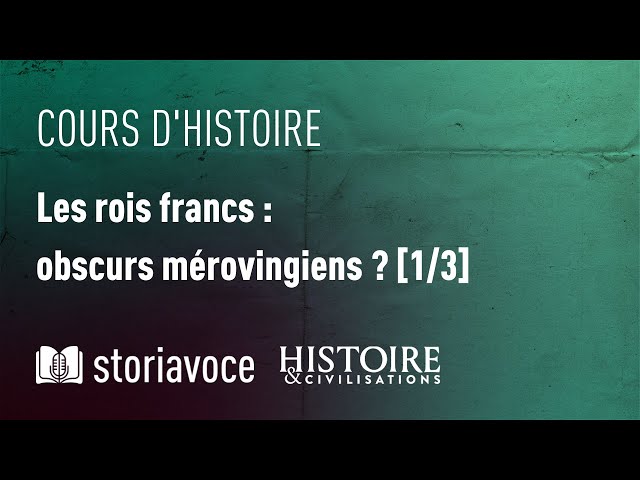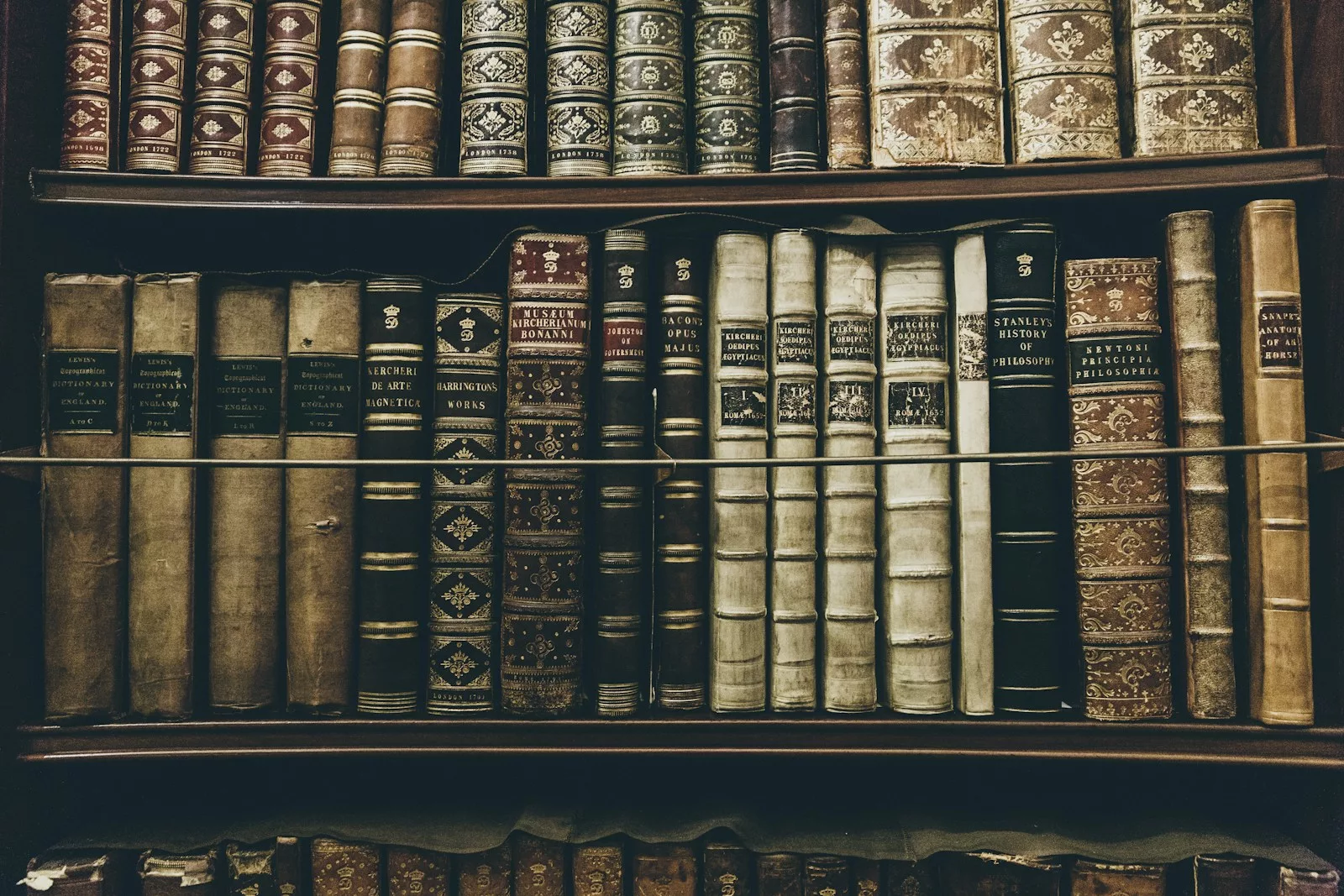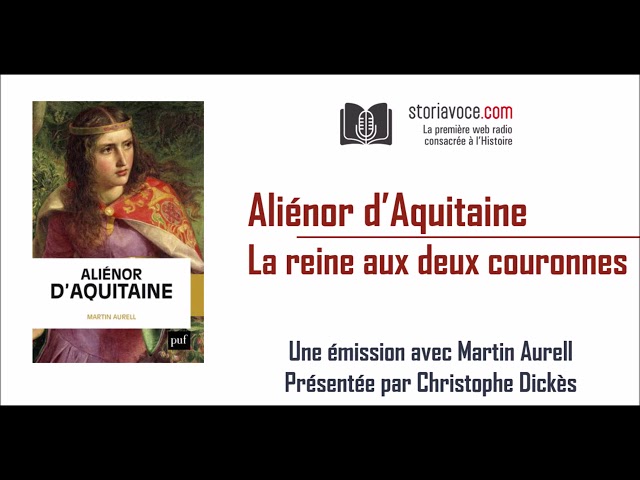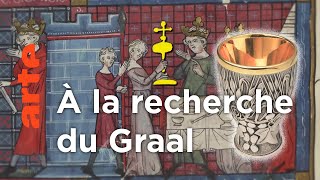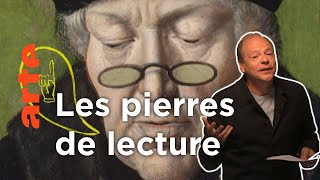Si Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, est un tant soit peu connu du grand public, c’est grâce au célèbre roman de Maurice Druon, Les Rois maudits. Écrasé par la stature d’un frère qui a laissé dans l’histoire une trace « royale », on peut le dire, Charles de Valois ne mérite pas moins quelque intérêt.
Et s’il apparaît, dans Les Rois maudits, comme une véritable caricature du grand féal, « fort en gueule », batailleur, ambitieux et prétentieux, il faut reconnaître que ce portrait est fort proche de la réalité.
Fils de roi, frère de roi, père de roi, Charles de Valois ne fut jamais roi lui-même… et ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé !
Résumé des points abordés
L’héritage des Angevins
En 1266, le pape Innocent IV avait investi Charles d’Anjou, frère de Saint Louis, du royaume de Naples et de Sicile, royaume qu’il avait « confisqué » à Manfred, héritier de Frédéric II de Hohenstaufen.
L’autorité de l’Angevin s’était rapidement établie sur l’Italie entière et ses ambitions le portaient même vers Constantinople lorsque, en 1282, commença l’insurrection sicilienne dont le signal fut donné, le 31 mars, par le massacre des Vêpres siciliennes.
Pour tous ceux qui ne voulaient plus de cette royauté et de cette noblesse capétienne, pour tous ceux que la politique oppressive de Charles Ier d’Anjou avait poussés à bout, le recours fut en Pierre III d’Aragon, époux de Constance de Hohenstaufen, fille unique et héritière de Manfred. Pierre, soutenu par nombre de partisans sur l’île même, conquit rapidement Palerme puis toute la Sicile.
Il y avait désormais deux royaumes de Sicile : l’île elle-même, passée dans l’orbite aragonaise, et le reste du royaume — Naples notamment — conservé par Charles d’Anjou.
L’espoir aragonais
Mais en « déboutant » ainsi un souverain choisi par le pape lui-même, Pierre III d’Aragon avait désobéi à la papauté. La sanction fut immédiate et sans appel : il fut excommunié et son royaume d’Aragon à son tour confisqué.
Voilà qui était fort bien « sur le papier », mais qui allait se dévouer pour lever une armée et prendre son royaume à Pierre III ? Philippe III le Hardi, fils de Saint Louis, accepta sans se faire trop prier. Il avait lui-même quelques griefs contre l’Aragonais, à qui il reprochait d’avoir écarté de la succession castillane ses neveux espagnols.
En outre, son fils cadet, Charles de Valois, paraissait tout désigné pour régner sur l’Aragon : n’était-il pas à moitié aragonais par sa mère, Isabelle, première épouse de Philippe III ? Charles, encore jeune, se voyait donc déjà ceindre la couronne que lui avait promis son père.
« Et la croisade d’Aragon, note Favier lapidaire, fut un complet échec ». Non seulement les Français furent battus avant même d’avoir passé les Pyrénées, mais Philippe III mourut lors de la retraite de son armée.
Son successeur, Philippe le Bel, prit les choses en main avec un tout autre objectif. Ne voyant pas l’intérêt de la France à poursuivre cette aventure, il signa rapidement une trêve et Charles de Valois revint à Paris, sans couronne.
Une dot plutôt qu’une couronne
Charles n’eut donc d’autre choix que d’abandonner toute prétention à cette couronne chimérique, abandon qu’il « officialisa » en 1290 afin d’obtenir la main de Marguerite d’Anjou.
Fille de Charles II d’Anjou, roi de Naples, et sœur de Charles Martel, roi de Hongrie, Marguerite lui donna cinq enfants, dont le futur Philippe VI, et lui apporta en dot deux comtés bien plus réels que la couronne aragonaise : l’Anjou et le Maine.
L’affaire était intéressante, non seulement en raison de la richesse de ces deux comtés qui faisaient du frère du roi l’un des féodaux les plus puissants, mais également pour le roi de France qui voyait ces terres revenir dans le giron capétien.
Une couronne byzantine
Mais Charles de Valois n’avait pas abandonné pour autant tout espoir de ceindre une couronne. Veuf depuis peu, il épousa en 1301 Catherine de Courtenay, petite-fille de Baudouin II, empereur de Constantinople, dont il eut quatre enfants.
La couronne aragonaise lui avait échappé ? Qu’à cela ne tienne ! Représente-t-elle vraiment quelque chose comparée à la couronne impériale de Constantinople ? Certes, depuis 1261, les Grecs avaient repris la ville et l’Empire latin d’Orient n’avait plus la moindre réalité. Mais il ne tenait qu’à Charles de redonner vie à cet empire fantôme.
Mauvais politique mais excellent capitaine, il prouva à maintes reprises son talent militaire au service de son frère. Charles avait aussi l’ambition nécessaire pour incarner cette chimère. Mais avant Constantinople, il devait agir en Italie, où le pape lui avait demandé de pacifier ses États et de chasser les Aragonais de Sicile.
Or, à peine arrivé, il multiplia les faux pas, contracta de mauvaises alliances et compromit gravement l’image capétienne. La situation devint intenable, au point que Philippe le Bel dut le rappeler en urgence après la défaite de Courtrai en 1302. Charles, humilié, revint en France avec au moins le titre et le rêve.
La course à l’Empire
La mort, en 1308, d’Albert de Habsbourg ralluma ses ambitions. Cette fois-ci, il s’agissait du Saint Empire romain germanique, et Philippe le Bel dirigea la manœuvre. Avec l’appui du pape, Charles fut présenté comme candidat à la succession impériale.
Il ne possédait aucune terre d’Empire, mais parce qu’il était Capétien, son élection pouvait apparaître comme un compromis mettant fin au conflit entre Guelfes et Gibelins. Philippe le Bel espérait le guider et le manipuler, tandis que le pape voulait un empereur croisé.
Mais les princes électeurs, lucides, refusèrent unanimement un tel scénario. Le 27 novembre 1308, ils élurent à la place le comte de Luxembourg. Une fois encore, une couronne s’éloignait de Charles de Valois.
Dans le même temps, il abandonna ses prétentions sur l’Orient. Devenu veuf pour la seconde fois, il transmit ses droits à sa fille Catherine, qui, en épousant Philippe de Tarente, transféra ces prétentions à la maison d’Anjou.
Le destin d’un éternel prétendant
Ainsi se conclut le destin étonnant, parfois cocasse, de Charles de Valois. Celui qui ne fut jamais roi, malgré ses rêves inassouvis et ses échecs répétés, engendra pourtant une dynastie qui allait régner trois siècles durant sur la France.