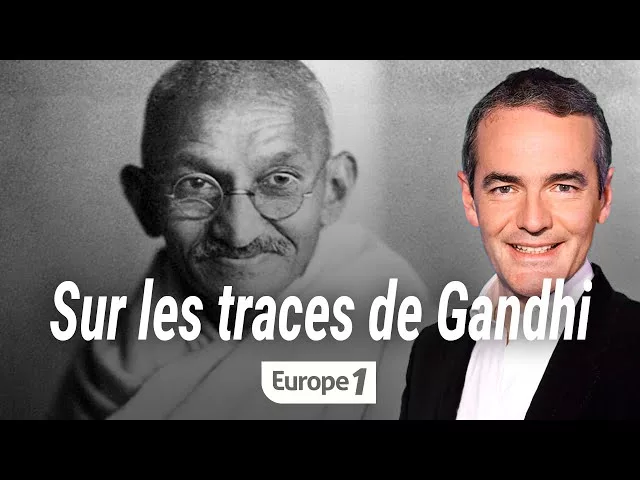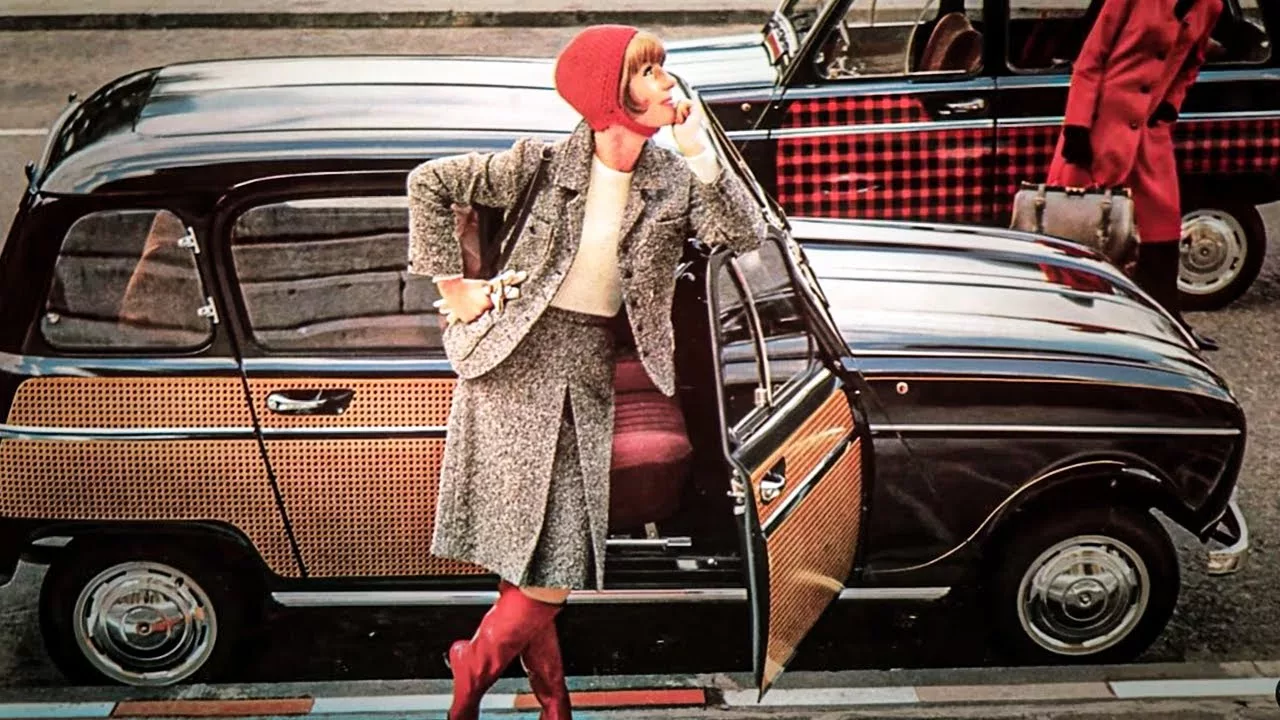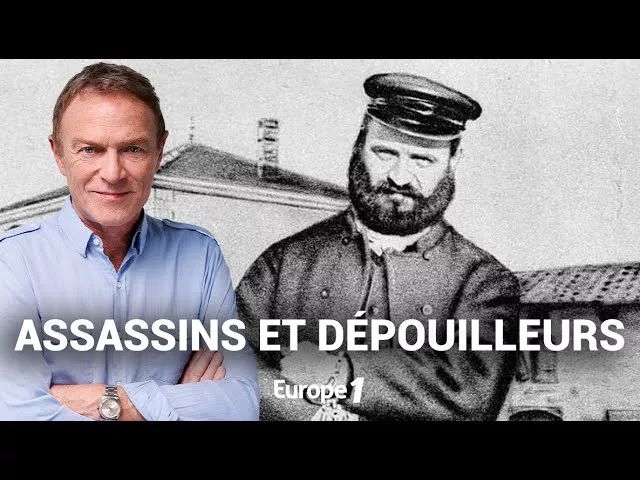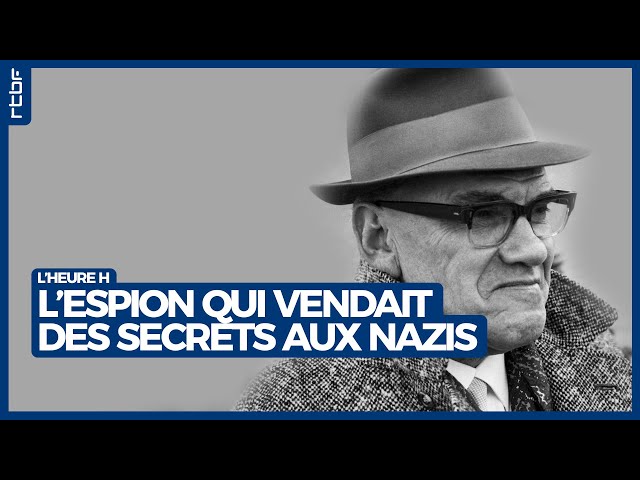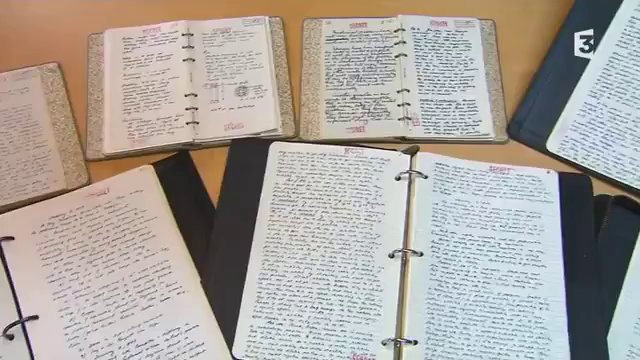L’entre-deux-guerres est une période officiellement en paix, mais profondément instable. Après 1918, l’Europe tente de reconstruire une économie ruinée, modernise ses sociétés, élargit le droit de vote et voit naître de nouveaux courants artistiques, scientifiques et techniques. Pourtant, sous cette surface progressiste, les fractures sont immenses : le traité de Versailles humilie l’Allemagne et crée un sentiment de revanche, les dettes de guerre paralysent les finances, et la crise économique mondiale de 1929 détruit la confiance dans les démocraties.
Dans ce contexte d’incertitude, les régimes autoritaires gagnent du terrain : fascisme en Italie, nazisme en Allemagne, militarisme au Japon, en exploitant le chômage de masse, le nationalisme et la peur du chaos social. La coopération internationale échoue, la Société des Nations n’a pas de force réelle, et les crises successives (réarmement, expansion japonaise, guerre d’Espagne, Anschluss) montrent que la paix n’est plus qu’une façade.
En 1939, l’Europe n’entre pas dans une nouvelle guerre par accident : elle y glisse parce que les tensions politiques, économiques et idéologiques n’ont jamais été résolues après 1918, elles n’ont fait que mûrir.